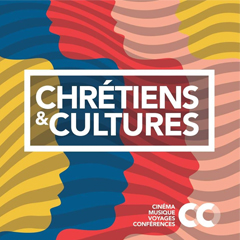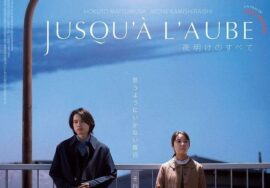Leïla et ses frères
Analyse du film : Leila et ses frères de Saeed Roustaee
Une révolte éclate dans l’usine où travaille Alireza. De son côté, son père, Esmail, se rend chez Bayram, qui a perdu son père. Ce dernier était le parrain de la communauté, la plus haute distinction de la tradition persane. Dans la maison familiale, Leila vit avec ses parents et deux de ses frères, Alireza et Fahrad. Alireza annonce à Leila qu’il a perdu son travail à l’usine. Pour sauver sa famille criblée de dettes, Leila a un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entrainent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.
Avec Leila et ses frères, chronique familiale s’interrogeant sur l’héritage d’un modèle traditionaliste et patriarcal en Iran, c’est donc encore une fois les rouages de la société iranienne que Roustaee entreprend d’ausculter via le prisme de cette ‘’simple’’ histoire de famille. À travers ses protagonistes, il filme une misère sociale dont il est presque impossible de s’extirper, entre un contexte économique qui condamne automatiquement les plus démunis et un système sociétal engoncé dans des schémas traditionnels proprement absurdes.
En mettant frontalement en scène le conflit intergénérationnel qui existe entre Heshmat et ses enfants, le film aborde également des questions sociétales très actuelles dans un pays comme l’Iran. À mi-parcours, les personnages se retrouvent ainsi face à un dilemme moral à priori insoluble, coincés entre un pragmatisme (qu’incarne Leila) pourtant évident qui leur permettrait de sortir du marasme ou se conformer à la volonté patriarcale, quand bien même cette dernière se base sur des traditions d’un autre temps (point de vue défendue par Alireza). C’est dans ce combat des idées qu’émerge le cœur battant du film. Intelligente et pleine de bon sens, Leila incarne la frange progressiste d’un Iran en crise, prête à mener une révolution au sein de son cocon familial pour contrer l’ordre établi. Pourtant, la jeune femme est constamment ramenée à son statut de subalterne, inhérent au système patriarcal dans lequel elle vit. Leila doit user des stratagèmes les plus subtils pour faire entendre sa voix et ses idées. Une guerre de la ‘’réflexion contre les convictions’’ comme elle le déclare à son frère dans l’un des plus beaux dialogues du film.
Entre le Bergman de Sonate d’automne et l’Ettore Scola d’Affreux sales et méchants, Leila et ses frères met à nu la société iranienne, observe et déchiffre ses entrailles. Saeed Roustaee autopsie la société iranienne via une fresque familiale fleuve et faussement intime, dont les enjeux dramatiques traduisent en filigrane les bouleversements sociétaux sous-jacents d’un pays aux prises avec ses propres contradictions. Ce film puissant, poignant et pratiquement en huis clos est une source de réflexion sur la famille, le conflit, la parole, le pardon et nous montre que le progrès, avant d’être économique et technologique, trouve ses racines dans la liberté et l’éducation.
Philippe Cabrol