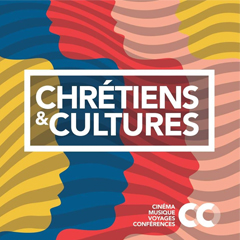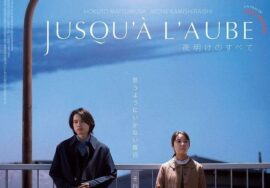Trois mille ans à t’attendre
Analyse du film : Trois mille ans à t’attendre de George Miller
Quel beau titre…pour un film magnifique.
George Miller fait partie des grands conteurs du cinéma contemporain : il est de ceux pour qui le septième art doit conduire le public à travers des contrées inexplorées et inespérées. Avec la nouvelle d’A.S. Byatt, le cinéaste australien a trouvé un catalyseur suprême : un récit en huis clos – deux personnages dans une chambre d’hôtel – qui ouvre sur une multitude d’histoires. Dès le premier plan, Alithea, l’héroïne, prend la posture de narratrice et prévient que ce qui suit, bien que ce soit vrai, sera plus acceptable si on le prend sous forme de conte de fées. On retrouve un thème cher au réalisateur: pour que quelque chose devienne réelle, il faut juste accepter d’y croire.
Trois mille ans à t’attendre, présenté Hors Compétition au Festival de Cannes 2022, est une œuvre qui réfléchit à ses propres procédés de mise en abyme, à la transmission des histoires rapportées. Son héroïne intellectualise les mythes et légendes ; le djinn en ravive l’essence.
Le récit débute à Istanbul où une professeure en narratologie Alithea fait l’acquisition d’un flacon dans une boutique d’antiquité. À l’intérieur de celui-ci, un djinn n’attendait que de pouvoir sortir pour concrétiser les trois vœux qui le sauveront. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Le djinn plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Les deux protagonistes vont alors se lancer dans une conversation profonde et métaphysique, interrogeant aussi bien l’avenir de la science et l’évolution de la fiction, que des sujets plus intimes comme l’amour et la solitude, tout en revisitant les 3 000 ans de souvenirs de l’être magique. Réunis dans une chambre d’hôtel, le djinn et l’universitaire vont disserter sur la puissance des mythes, la science du récit et les inconstances du cœur.
Le récit va donc opérer des allers-retours entre le présent et le passé du djinn, dont les trois histoires d’amour l’ayant précipité dans le flacon, prennent vie par le truchement d’effets spéciaux somptueux. Le film oscille entre l’intimisme de la conversation entre Alithea et le djinn, et l’épique du conte narré. Lorsque le djinn raconte son histoire, celle-ci est portée à l’écran par une abondance à l’image de détails, de créatures merveilleuses, de riches ornements architecturaux. Miller nous entraine dans un conte digne des Mille et une nuits et nous sommes transportés au temps de la Reine de Saba, du Roi Salomon, des guerres turco-persanes, de l’ingéniosité du XIX siècle,…
En narrant l’histoire du djinn de la sorte, le cinéaste embrasse par sa mise en scène ce que sous-entend le génie. Celui-ci, en contant l’histoire de ses vies antérieures, cherche à montrer à Alithea experte en histoires qu’il subsiste en celles-ci une pièce du puzzle de l’âme humaine. Alithea espère trouver dans ce conte millénaire une complétude à son existence, une réponse à la question « qu’est-ce que je souhaite ? ». Ce que figure Miller avec Trois mille ans à t’attendre, c’est que les histoires permettent, au-delà de la science ou la rationalité, d’éclairer des zones d’ombres de l’âme humaine. Alithea – dont le nom est celui de la déesse grecque de la vérité – a besoin de quelque chose de plus pour atteindre la vérité de ses sentiments. Les histoires passionnées du djinn font comprendre à Alithea « sa pièce manquante »: un besoin d’amour et le film interroge la confusion entre le besoin d’amour et la solitude qui ronge l’âme : l’amour souhaité unilatéralement ne serait que poudre aux yeux.
Les histoires du djinn font penser aux lanternes magiques, ancêtres du cinéma : une projection d’images, une extension du conte oral. Miller célèbre ainsi le pouvoir de la narration, de la transmission par l’oralité, de la fiction et de l’imagination.
Trois mille ans à t’attendre témoigne du désir de regarder le monde autrement pour accéder à un autre monde, en l’occurrence un monde d’avant la science, tissé à partir des histoires et des mythes, qui ne remplace pas le monde tangible mais l’approfondit. L’imagination est appréhendée dans le film comme une clef ouvrant les portes de la perception. C’est l’idée, magnifique, au cœur de la mise en scène de Miller : pour mieux voir, il faut d’abord croire, et plus encore croire que notre vie intérieure permet l’accès à une compréhension plus vaste et sensible de ce qui nous entoure. Pour ce faire, Miller organise un dialogue constant entre le matériel et l’immatériel (la fiction, le fantasme, mais aussi les vapeurs, les ondes magnétiques et le « feu subtil » dont sont faits les djinns).
George Miller aborde aussi les thématiques communes qui abondent ses films : l’écologie, la puissance des images, le goût du symbolisme dans la composition picturale des plans, dans la profusion d’images, de costumes
Trois mille ans à t’attendre se présente comme une re-visite actuelle des contes des Mille et Une Nuits où deux êtres solitaires se trouvent en se racontant des souvenirs passés. Georges Miller fait de son film une œuvre bouleversante sur le hasard terrible de la vie, sur ce mouvement permanent du temps et ses enchaînements de causes et de conséquences qui peuvent graver dans le marbre certaines existences, ou au contraire les effacer.
Philippe Cabrol