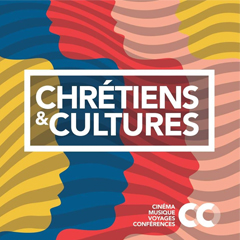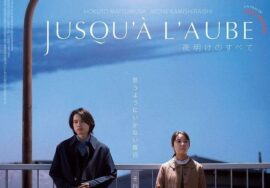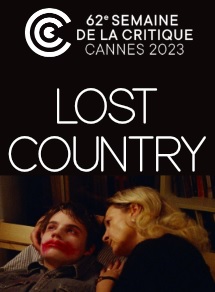
Lost country
Analyse du film : Lost country
Semaine de la critique à Cannes 2023
Nationalité : France, Serbie, Croatie, Luxembourg ; Genre : Drame
Durée : 1h38min
Date de sortie : 11 octobre 2023
Réalisateur : Vladimir Perisic
Acteurs principaux : Jasna Djuricic, Jovan Ginic, Miodrag Jovanovic
Aussi sobre que bouleversant, le deuxième long métrage de Vladimir Perišić Lost country, presque quinze ans après son premier film, Ordinary People, confirme son goût pour les dilemmes moraux et sa volonté d’explorer l’histoire récente, chaotique et douloureuse, de la Serbie. Lost country raconte l’emprise d’une mère apparatchik sur son fils alors que la jeunesse se révolte, en1996.
Serbie, 1996. Pendant les manifestations étudiantes contre le régime de Miloševic, Stefan,15 ans, mène dans le feu des événements sa propre révolution : accepter l’inacceptable, voir dans sa mère – porte-parole du parti au pouvoir – une complice du crime et trouver, malgré l’amour qu’il ressent pour elle, la force de la confronter.
Que faire quand on a 15ans et qu’on est pris dans un tel conflit intérieur ? Dans Lost Country, ce n’est pas seulement un pays que l’on perd, mais bien une famille –celle de Stefan s’est construite sur le mythe d’un grand-père résistant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale qui a appelé sa fille Marklena parce que c’est la contraction de Marx et Lénine– et une jeunesse encore innocente.
Pour bien comprendre les prémices du film, il faut se souvenir du contexte. Quand Milosevic, pur produit de la bureaucratie communiste est élu président de Serbie en 1989, le communisme est en déliquescence dans tous les pays de l’Europe de l’Est. Pour marquer le coup d’un «renouveau» à son arrivée au pouvoir, il transforme le Parti communiste yougoslave en Parti socialiste. Un ultra-nationalisme qui séduit et galvanise les Serbes, qui le réélisent au suffrage universel en 1992 et en 1997. Mais les deux guerres successives qu’il lance au cours de l’été 1991 contre la Croatie et en mars 1992 contre la Bosnie-Herzégovine, sur fond de nettoyage ethnique et de génocide en plein cœur de l’Europe (on se souvient du tristement célèbre massacre de Srebrenica en juillet 1995), ainsi que la fraude électorale généralisée, divisent largement le pays. Une vague de protestations étudiantes se soulève en 1996, que le régime de Milosevic tente de réprimer férocement. La Serbie est au bord de la guerre civile. Le régime autoritaire du parti socialiste de Slobodan Milosevic – qui sera inculpé, trois ans plus tard, pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide au Tribunal pénal international de La Haye — réprime violemment les manifestations en faveur d’une transition démocratique. Dans ce climat explosif, le jeune Stefan, 15ans, se trouve en première ligne: sa mère, l’altière et charismatique Marklena (prénom-valise en hommage à… Marx et Lénine), qui l’élève seule, devient la porte-parole d’un gouvernement honni.
Dans l’ombre de la guerre civile en ex-Yougoslavie (ce «pays perdu» qu’annonce le titre, et qui est aussi celui de l’innocence du jeune héros, avant sa prise de conscience), le réalisateur livre un récit d’apprentissage torturé. La chronique d’un inexorable et déchirant désamour filial est aussi une autopsie politique au scalpel, où l’intenable conflit de loyauté vécu par Stefan fait écho aux convulsions d’une nation en butte à son histoire, et à ses propres crimes et trahisons idéologiques.
Stefan est au cœur d’une guerre de famille digne d’une tragédie grecque…Car sa mère, avec qui il entretient une relation fusionnelle, est la porte-parole du gouvernement de Milosevic. S’il brûle de rejoindre l’expérience collective de cette fête magnifique qu’est la révolution, le paradoxe de sa situation l’empêche de s’y greffer. Dans ce contexte, comment ne pas éprouver un double conflit de loyauté – d’une par envers sa famille et d’autre part envers une sorte d’impératif moral intérieur? Comment d’un autre côté ne pas voir cette mère si aimante comme une victime, aliénée par les idées délétères d’un système politique patriarcal, voix du parti n’ayant pas sa propre voix?
Vladimir Perišić travaille comme un pointilliste, ajoutant plan après plan une touche signifiante, un détail ou un regard qui vient étoffer chaque personnage. Cette mise en scène précise s’organise autour de répétitions grimaçantes : un repas avec les grands-parents, source de joie simple, devient insupportable à mesure que la politique s’immisce entre le plat et le dessert ; une étreinte complice avec la mère se révèle douloureuse après une manifestation. Ou encore des séquences remarquables parmi lesquelles le développement de la relation de l’adolescent avec sa mère, notamment quand la mère déposant un baiser sur la joue de son fils, son rouge à lèvres le marque d’un «poinçon fatal». En multipliant les plans fixes dans l’appartement des deux protagonistes, Vladimir Perisic filme magnifiquement l’intimité et les non-dits
Cri de rage autant que d’amour, Lost country est passionnant, tant par l’ambivalence de son sujet que ses choix de mise en scène, que le cinéaste travaille tel un orfèvre. Les protagonistes sont souvent séparés par le cadre, dans des plans aussi fixes que leurs positions morales, sur fond de couleurs chatoyantes et inconciliables et de fatalité symbolique, où le malaise se fait grandissant
Vladimir Perisic qui s’était déjà penché sur le génocide perpétré par ses compatriotes en Bosnie dans le glaçant Ordinary people (2009), s’intéresse à nouveau à la question de la banalité du mal. À travers les rapports de plus en plus tendus entre Stefan et sa mère, le cinéaste ausculte fiévreusement son propre trauma d’adolescence (il était, lui aussi, le fils d’une femme politique liée au régime).
Lost country rappelle fatalement cette phrase du Guépard(1963) de Visconti: «Il faut que tout change pour que rien ne change»… Un appel à éviter la fatalité, celle d’un pays, d’une famille, d’un cœur.
Philippe Cabrol
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.