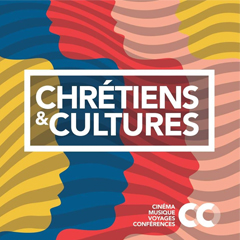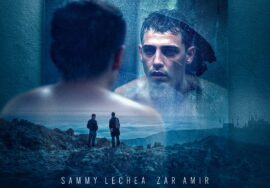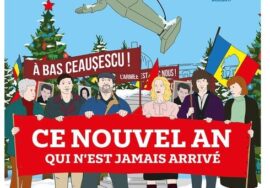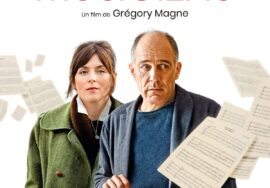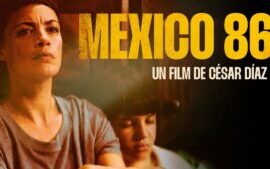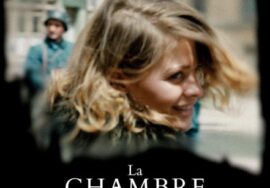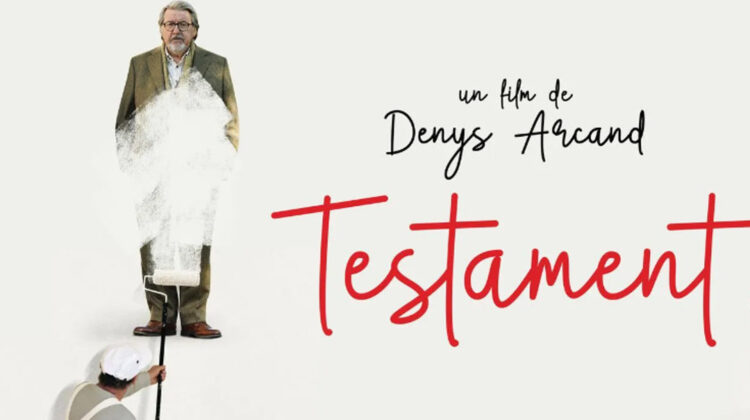
Testament
Analyse du film : Testament de Denys Arcand
Nous avons tous en tête les inoubliables Les Invasions barbares ou La chute de l’Empire américain, des œuvres de Denys Arcand d’une acuité folle qui analysent et décortiquent la société et notre monde dans sa globalité.
A l’origine du film Testament, il y un événement dans un musée new-yorkais. Alors que les manifestants ont migré pour faire interdire une pièce de Berthold Brecht, le ministre de la Culture déboule furieux à la maison des aînés: la fresque était classée et la directrice est sommée de s’expliquer. La même députée qui avait pris fait et cause pour les manifestants condamne la disparition de la fresque car «on ne gouverne pas avec la réalité mais avec les apparences». La directrice est mutée.
«C’est un événement qui s’est déroulé dans un grand musée de New-York qui m’a donné l’idée du film» raconte Denys Arcand. « Sur une grande fresque murale, on voyait la rencontre d’Indiens de l’île de Manhattan avec un explorateur hollandais. »
Denys Arcand peint dans Testament, son dernier film, le portrait d’une société dont il explore les travers, les incohérences et les excès. Avec un plaisir non dissimulé, le spectateur assiste au procès de notre société et ses dérives actuelles, qui confinent à l’idiocratie, sous la loupe grossissante d’une caméra aussi généreuse qu’impitoyable. Tout y passe. Les manifestants, les sportifs compulsifs, les politiciens hypocrites, les médias producteurs de scandales …
Il reçoit un prix littéraire au milieu de féministes déchaînées. Mais il y a erreur sur la personne: le véritable lauréat est un homonyme. Ainsi commence le film. Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n’avoir plus grand chose à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d’une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette époque post pandémique où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres.
L’ époque désole Denys Arcand. C’est le monde à l’envers. L’inculture le dispute à la bêtise, l’enfer se pare de slogans bien intentionnés. Le cinéaste a donc créé ce type de «l’homme ordinaire», qui sait résister au chaos ambiant par sa capacité d’écoute et d’empathie.
Denys Arcand continue de traiter le thème de la lente désintégration de notre civilisation. «Nous entrons maintenant dans un monde radicalement nouveau, qui s’appellera la civilisation numérique, ou informatique, ou je ne sais quoi. L’arrivée de l’intelligence artificielle va maintenant pulvériser nos dernières certitudes» déclare-t-il.
Testament se présente aussi comme le premier long-métrage à poser un regard acerbe et critique sur l’idéologie woke. De même, la cancel culture est tristement épinglée au travers de la disparition des livres (la bibliothèque des aînés se vide de ses livres sur ordre du ministère qui estime désormais que les résidents seront plus stimulés intellectuellement par les jeux vidéo. Et les livres seront recyclés en papier-cadeau), et de la perte de la notion de l’art. Les nouvelles formes d’écriture abusivement inclusives y sont moquées à raison, avec une démonstration empirique implacable. La discrimination positive, ou plutôt ses excès, sont démontés avec bruit et fracas. Les dérives totalitaires de la période Covid et la bêtise de nos dirigeants politiques sont mises en évidence avec une drôlerie déconcertante. Les médias sont ridiculisés par leur côté sensationnaliste et d’information par le vide. La bêtise ambiante qui gangrène le monde est présentée telle qu’elle est et cela fait du bien de voir qu’un long-métrage ose défier les narratifs qui polluent tous les canaux d’information.
Mais une certaine tendresse n’est pas exclue quand il s’agit de décrire les mœurs des seniors aux lesquels il reste les jeux vidéo comme distraction. «A 3000, je suis un super-héros» dit un vieux monsieur aux cheveux blancs qui s’excite sur ma manette depuis 5 heures ou cette vielle dame qui confond la souris de l’ordinateur avec un téléphone.
Satire aussi mordante, affutée et réussie, le réalisateur ne dénigre pas les progrès sociétaux et les avancées identitaires. Il démolit juste les excès de ces nouvelles normes, montrant que dans chaque avancée, la mesure est de rigueur. C’est à la fois politique, sociétal, jubilatoire, jouissif et moqueur.
Philippe Cabrol