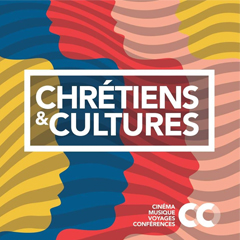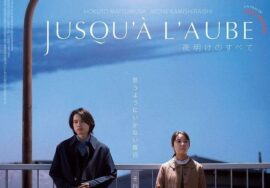Une part manquante
Analyse du film : Une part manquante de Guillaume Senez
Sortie le 13 novembre 2024 en salle | 1h38min | Drame
Avec : Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki
Après avoir raconté la parentalité d’un très jeune couple dans Keeper puis celle d’un père seul dans Nos batailles, le réalisateur belge Guillaume Senez aborde une nouvelle fois cette question à travers l’histoire d’un père installé à Tokyo pour retrouver sa fille Lily, qu’il n’a pas vue depuis neuf ans.
Jérôme, « Jay », la quarantaine, chauffeur de taxi à Tokyo, s’apprête à rentrer en France après avoir cherché en vain sa fille Lily, Il doit signer la vente de sa maison quand soudain, une jeune fille qui ressemble beaucoup à sa fille, entre dans son taxi, une jambe dans le plâtre.
Avec ce troisième long-métrage, Guillaume Senez aborde le sujet des «enfants volés» du Japon. C’est un aspect passionnant du film : Une part manquante lève le voile sur un phénomène terrible qui sévit au Japon et que peu de gens connaissent. L’histoire de Jérémy / Jay est en effet celle que vivent chaque année près de 150 000 parents, tous milieux sociaux confondus…
150 000 : c’est le nombre de mineurs kidnappés par l’un de ses deux parents, privant l’autre de toute relation.
Au Japon jusque très récemment, la garde partagée n’est pas une option légale. La garde revient à celui qui s’empare en premier des enfants. Et selon la loi nippone, ces enlèvements par les géniteurs ne sont pas considérés comme des délits, dans un pays où l’État ne se mêle surtout pas des histoires de famille, et encore moins de celles des couples . Ici, quand un couple avec enfant se sépare, un seul parent garde l’autorité parentale, l’autre devenant un simple tiers. Alors, pour peu que la séparation soit conflictuelle et que, de plus, un des deux conjoints ne soit pas de nationalité japonaise, le parent le plus rapide n’hésite pas à partir du jour au lendemain avec sa progéniture, sans laisser ni trace ni adresse: la première ou le premier qui part avec l’enfant en a la garde exclusive.
Ce problème est loin de ne toucher que les parents étrangers et il parait même que 60 à 70 % des japonais aimeraient faire bouger les lignes sur ce sujet. Dans les pays occidentaux, la justice considère qu’un enfant doit être éduqué par ses deux parents même quand ceux-ci ne vivent pas ou plus ensemble. Au Japon, on estime que pour bénéficier d’un environnement stable, un enfant ne peut vivre que sous un seul toit et sous une seule autorité parentale. Donc, le parent à qui la garde est confiée peut se réfugier dans sa famille ou créer un nouveau foyer sans que le conjoint écarté puisse prétendre à quelques droits vis-à-vis de l’enfant qui est pourtant le sien. Une situation qui s’envenime quand il s’agit de couples binationaux, même si la convention de La Haye, censée protéger les enfants des effets nuisibles des enlèvements et mentionnant que l’enfant doit pouvoir communiquer avec ses deux parents, a été ratifiée par le Japon en 2014. Cependant, le 17 mai 2024, le Parlement japonais a voté une modification du Code civil, recommandant une autorité parentale conjointe, en cas de divorce. Cette loi n’entrera en application qu’en 2026.
Dans le film c’est très habilement au travers du personnage de Jessica, une française que Jay aide dans ses recherches et qui n’a aucune connaissance des codes japonais, qu’il nous est expliqué ce que Jay a traversé depuis des années. Alors, au fil des ans, Jay s’est résigné, il est dans une retenue absolue, il garde tout à l’intérieur. Il s’est fondu dans le moule et la foule, devenant plus japonais qu’un Japonais… Il parle parfaitement japonais, il connaît le plan de la ville sur le bout des doigts, fréquente un sento (les bains japonais publics d’eau chaude), ainsi qu’une «salle de fureur», espace payant pour évacuer ses frustrations et passer ses nerfs en détruisant des décors de bureaux. Pourtant son statut reste celui du Gaijin, de l’étranger.
Lui, l’ancien chef cuisinier si fougueux, si passionné, est devenu un citoyen très discret, respectueux des règles et des normes, dévoué à son travail, un employé modèle. Quand il rencontre Jessica, dont le conjoint japonais vient d’enlever le fils, il se revoit des années en arrière. Cette même rage de tout balancer, cette même furieuse croyance que le scandale va régler la situation… mais c’est peine perdue. Alors il va prendre Jessica sous son aile, lui apprendre le calme et la retenue et partager avec elle ce qu’il a appris pour qu’elle puisse garder un lien, aussi ténu soit-il, avec son fils.
Récit d’une obstination tournant à l’obsession, le long métrage fait preuve d’une très grande pudeur que semblent imposer les règles de vie en communauté au Japon. L’injonction à «ne pas faire de scandale», telle une crainte ultime, revient d’ailleurs plusieurs fois au cours du film. S’installe ainsi au fil du récit, un calme apparent de surface, bien que l’on devine le bouillonnement intérieur des personnages occidentaux. Car en accompagnant Jessica dans son quotidien, c’est toute la politique parentale et le fonctionnement de la garde des enfants en cas de séparation qui est ici radiographié, donnant du Japon une image bien moins flatteuse que dans beaucoup de films nous montrent. Alors que la rage de Jessica et la détresse de Yu, autre personnage marqué par le même destin, tranchent avec le calme apparent de Jay, l’on comprend que les cicatrices de ses plaies sont fragiles, prêtes à se rouvrir et à causer leur lot de souffrances.
Une fois encore, Guillaume Senez raconte un homme qui trouve son salut par la grâce de personnages féminins qui l’élèvent et l’extraient de son aveuglement. Le réalisateur a déclaré: «C’est un peu toujours la même chose dans mes films, on a un personnage masculin un peu borderline, limite agaçant, à qui j’essaie d’insuffler un peu d’humanité. Et ce personnage est toujours entouré de personnages féminins qui le font grandir, évoluer. Ici on a son avocate Michiko qui lui conseille d’y aller doucement, quand Jessica lui dit l’inverse, il est un peu perdu, tiraillé entre les deux».
On retrouve la sobriété dans la mise en scène du réalisateur belge, la ville de Tokyo filmée en arrière-plan, en mouvement, à travers les vitres du taxi de Jay. Si le film reste focalisé sur le personnage principal, le réalisateur complète le tableau de ce phénomène de société avec les histoires des différents personnages secondaires, ainsi le père japonais au bord du suicide, ou Jessica, ces parents privés de leurs enfants.
Suivre Jay au volant de son taxi dans la nuit de Tokyo est une aventure très cinématographique: la ville, les néons, les visages des clients qui se suivent et ne se ressemblent pas, ce mélange de modernité et de tradition… On va le suivre aussi dans sa lente métamorphose, au fur et à mesure qu’il vit cette rencontre inespérée, comme si soudain il remontait à la surface d’un très long sommeil, retrouvant la fragile beauté des émotions. Cette voiture sert de cadre dans le cadre dans Une part manquante. Reprenant un dispositif sublimé par Ten d’Abbas Kiarostami (2002), nombre de scènes sont tournées à l’intérieur, la caméra jouant avec tous les champs et contrechamps qu’autorisent les échanges entre chauffeur et passagers, les vues à travers les vitres et les coups d’œil dans les rétroviseurs.
Ce film n’est pas un drame sombre. Guillaume Senez met en lumière la solidarité qui s’installe entre ses protagonistes, et accompagne Jay dans sa recherche de rédemption. Une part manquante est un témoignage fort autant qu’une œuvre artistique complète et sincère. Le film rappelle la bataille de Vincent Fichot, père devenu symbole de cette revendication par sa grève de la faim médiatisée durant les JO de Tokyo, à l’été 2021, pour réclamer de revoir ses deux enfants enlevés par leur mère japonaise.
Ajoutons que l’une de nos grandes inspirations du réalisateur, fut le film Le samouraï de Jean-Pierre Melville : pour la musique, le découpage, mais aussi au niveau du scénario et la détermination du personnage.
Vous remarquerez que dans les voitures japonaises, le volant est à droite.
Philippe Cabrol
#analysedefilms #japon #romainduris