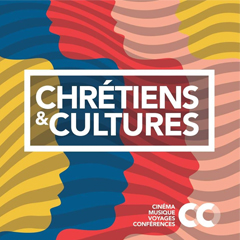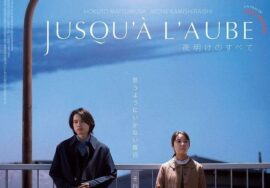Bergers
Analyse du film : BERGERS
En portant à l’écran le roman D’où viens-tu, berger? de Mathyas Lefebure, la cinéaste Sophie Deraspe s’était donnée la mission de réaliser un film qui fait du bien et qui fait voyager les spectateurs, à travers le choix de vie d’un jeune québécois voulant devenir berger.
BERGERS de Sophie Deraspe. Canada/France.
Sortie en salle le 9 Avril 2025, 1h53.
Avec : Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londés, Michel Benizri.
Sophie Deraspe a découvert le roman de Mathyas Lefebure en 2015 et a aussitôt été séduite par l’humour et la critique sociale qui se dégageait de ce récit en partie
autobiographique de l’auteur.
Trois parties composent Bergers : le désenchantement chez un éleveur où règne une violence sourde, le renforcement des convictions chez une éleveuse bienveillante et, enfin, la mise à l’épreuve lors de la saison d’alpage avec le troupeau, en montagne.
Dès le début du film, on fait la connaissance de Mathyas dans un petit hôtel de Provence, à Arles, au moment où il annonce sa démission à la boîte vocale de son patron. Malheureux dans le domaine publicitaire, le jeune Québécois a décidé de changer de continent et de se réinventer gardien de moutons.
Mathyas se met à lire sur le pastoralisme : un apprentissage autodidacte qui ne le prépare pas au choc du réel. C’est avec des livres sur la transhumance, un chapeau et une besace en cuir qu’il s’invite à « l’apéro » des bergers du coin pour se faire embaucher comme apprenti. Un des éleveurs, séduit par sa démarche, et par le manque de main d’œuvre, le prend à l’essai. Ce sera son premier échec.
Après l’enchantement de la nouveauté, le jeune homme se frotte à une réalité plus sourde et connait sa première vraie expérience. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent au bout « du rouleau ». Le père Tellier fait régner sur sa bergerie un tel climat de terreur que l’apprenti n’a que le choix de fuir. Mathyas déchante. On lui fait comprendre qu’il n’y a rien de spirituel à veiller sur un troupeau. Élever des moutons, c’est une industrie agricole à la merci de la mondialisation, du climat qui change, des maladies qui s’attaquent au cheptel. C’est une vie de sacrifices et de solitude.
C’est dans le cadre de la deuxième partie du film que Mathyas voit son choix professionnel se confirmer. L’arrivée d’Élise, une jeune fonctionnaire rencontrée au cours de ses péripéties administratives, qui a, elle aussi, tout laissé tomber, donne une nouvelle orientation à la quête de Mathyas. Tous les deux sont embauchés par Cécile Espriroux, fière bergère prospère, qui cherche un couple afin d’effectuer la transhumance d’un troupeau de 800 moutons dans les Alpes.
Finalement, le jeune québecois va réaliser « son fantasme de transhumance ». Avec Elise, il va traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. Ce déplacement saisonnier des bêtes d’un alpage à l’autre, en passant par de vieux villages médiévaux, l’étendue des montagnes et la beauté des vallées verdoyantes offrent des images absolument spectaculaires. C’est dans cette dernière partie que Bergers dévoile toute sa richesse, à travers ces détails qui témoignent de la vraie vie des bergers…
Il n’y a pas de flashbacks pour expliquer ce qui s’est passé dans la vie de Mathyas au Canada. Sophie Deraspe fait débuter son film alors qu’a déjà eu lieu la crise existentielle du protagoniste. En fuyant Montréal, Mathyas a pris la route d’une transformation intérieure. Son chemin l’amènera à devenir berger : surveiller les bêtes, en prendre soin, les accompagner dans leur transhumance.
Ce film nous montre que le jeune québécois se voit offrir plusieurs chances par des éleveurs, dont les différentes préoccupations et la force de caractère vont lui apprendre autant sur les réalités concrètes de la vie de berger que sur ses propres limites. La réalisatrice explore la souffrance d’une paysannerie abandonnée par l’État. Elle explique comment la résolution de Mathyas est mise à rude épreuve, que le mode de vie pastoral est très frugal et que c’est un travail harassant, où l’on régule son activité en fonction de la nature, mais où l’on ne compte pas ses heures.
Mathyas est donc vite confronté à la dure réalité d’une agriculture précaire, menacée par les pratiques industrielles. De façon authentique, ce longmétrage présente une réalité sociale, une culture et une tradition avec ses côtés les plus enviables et ses facettes les plus redoutées. La souffrance du berger n’est jamais montrée, sont seulement suggérées ses galères, ses peines.
Avec Bergers, nous sommes dans un pèlerinage philosophique où la quête du bonheur et de l’absolu s’oppose à la réalité et au consumérisme. Dès le début du film, Mathyas se présente avec une quête existentielle, presque spirituelle.
La thématique essentielle qui traverse ce film est la quête de sens. L’amour du métier et le dévouement sont les valeurs que Mathyas porte en lui et que la mise en scène éclaire. Ce film nous fait voir la paix intérieure, la bienveillance, la sérénité, ainsi que l’importance de la méditation.
Ce long-métrage évite la plupart des clichés sur la ruralité dans lesquels il aurait pu tomber. Les considérations écologiques et sociales sont les bienvenues, mais les enjeux d’actualité tels que la souveraineté alimentaire, les conflits entre les décisions politiques, la réalité des producteurs agricoles, les changements climatiques, … ne sont que survolés.
Bergers, dont l’écriture s’est faite en plusieurs étapes sur plus de 10 ans, est un solide récit d’apprentissage, un plaidoyer en faveur d’un métier menacé. Film quasi contemplatif, d’où émerge un cachet documentaire soulignant l’authenticité du récit, ce long-métrage repose avant tout sur la beauté pastorale de la photographie.
Les images superbes dans la voie de la transhumance vers les alpages offrent une véritable expérience sensorielle.
Cette œuvre, emprunte d’un regard humaniste, a remporté le prix du meilleur film canadien au dernier Festival international du film de Toronto. Hymne à la liberté, Bergers donne envie de partir à l’aventure, de communier avec la nature et de « mordre la vie à pleines dents ».
Philippe Cabrol
#analysesdefilms