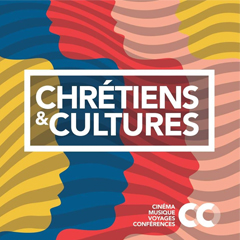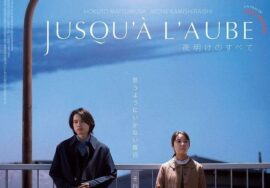Amélie et la métaphysique des tubes
Analyse du film : AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES
En 2000, avec Métaphysique des tubes, Amélie Nothomb livrait dans une autofiction les souvenirs de ses premières années de vie au Japon, de sa naissance à l’âge de trois ans. Elle s’y raconte en bébé apathique, un « tube » dénué de pensée comme de volonté.
Amélie et la métaphysique des tubes est un film d’animation qui a été présenté au Festival de Cannes 2025 et en compétition officielle au Festival international du film d’animation d’Annecy où il a obtenu le prix du public.
Réalisé par Maïlys VALLADE et Liane-Cho HAN – film d’animation, France, 2025, 1h17mn – Sortie en salle le 25 juin 2025
Scénario de Liane-Cho Han, Aude Py, Maïlys Vallade et Eddine Noël, d’après le roman Métaphysique des tubes d’Amélie Nothomb.
Amélie est une petite fille belge qui vit avec ses parents, son frère et sa sœur au Japon où le père est diplomate. Dès sa naissance, la petite Amélie est à part au sein de cette joyeuse tribu. Bébé, son regard vide incite à la qualifier de « légume ». Tout autour d’elle nourrit son imagination et son goût de l’aventure. Nishio-san, sa nounou va devenir une seconde maman pour elle. Grâce à elle, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses 3 ans, un évènement change la vie d’ Amélie et elle comprend qu’elle ne pourra pas passer toute sa vie au Japon.
Au commencement, il n’y a rien… Rien, à part… un tube ! c’est ainsi qu’Amélie se voit lors de son irruption sur terre, comme une espèce de Sainte Trinité qui oscillerait entre un tube digestif, un légume, ainsi qualifié par un pédiatre qui l’ausculte, et… Dieu, en toute simplicité. Les deux premières années de son existence, elle les passera dans un état végétatif dont son entourage devra se contenter après s’en être beaucoup inquiété puis désespéré. C’est alors que plus personne n’y croit que le miracle se produira, par la grâce d’une barre de chocolat blanc… et belge. Cette découverte gourmande a lieu lors d’une visite de sa grand-mère belge, et éveille Amélie à ses sens et à son intérêt pour l’univers. Dès lors elle se décide à prononcer son premier mot, qui ne sera pas le très attendu « maman » ou « papa », mais tout simplement « aspirateur ».
D’enfant absente, elle devient capricieuse seule sa nourrice Nishio-san parvient à la canaliser, et l’éveille à la culture japonaise. Persuadée d’être elle-même japonaise, la petite fille précoce participe aux célébrations et aux traditions nippones qui la fascine.
Vu du point de vue d’Amélie, l’histoire, nous emporte dans cette vie qui se partage en petit moments et grands instants, évoquant toutes ces choses qui font la vie d’un petit enfant. Tout comme dans le roman autobiographique d’Amélie Nothomb, le métrage s’attarde sur les trois premières années d’existence de son auteure.
Ce long -métrage est une évocation à portée universelle et d’une grande justesse de la petite enfance, de l’altérité, des liens familiaux, Les évocations de la guerre, de la pluie, du printemps, de la féminité, du chocolat blanc, de la famille, de la perte… sont magnifiques, tout en intelligence, finesse, beauté et drôlerie.
Le film fait le récit de moments fondateurs pour Amélie : le tremblement de terre, la découverte du chocolat blanc, l’aspirateur, les histoires, la découverte de l’extérieur. Des détails empreints de culture nippone sont magnifiquement retranscrits : l’importance des saisons, les fêtes traditionnelles, le parler ou encore le passé historique… Au fond de son cœur, Amélie n’est pas belge, mais japonaise. A travers le regard de l’enfant, le film traite également avec clarté de la complexité du monde : les blessures de la guerre, le décalage générationnel ou encore les différences culturelles. Amélie étant naturellement très curieuse, de question en question, d’apprentissage en apprentissage, elle s’interroge sur le sens de la vie, la mort, la tristesse, la colère et découvre le rapport particulier qu’entretiennent le Japon et l’Occident.
Un enchantement que l’on doit aussi à la superbe animation en 2D des cinéastes Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, avec le concours de Rémi Chayé au croisement des styles occidentaux et japonais, comme une mise en images de l’identité même de la fillette. Cependant, la naïveté et la tendresse apparentes du film ne dissimulent pas longtemps qu’Amélie et la métaphysique des tubes est aussi un apprentissage de la perte. Grandir, c’est comprendre que l’on ne peut pas tout garder auprès de soi, que l’on n’a pas, ni n’aura jamais la mainmise sur ce monde que l’on commence pourtant tout juste à rencontrer.
La conception graphique du film rappelle le mouvement pictural du fauvisme, Maïlys Vallade explique : Tout l’enjeu du film était de savoir comment nous allions réussir à traduire en image, en animation, la singularité de ce récit. Répondre à cette difficulté nous a conduit à développer notre grammaire cinématographique autour d’un parti pris affirmé: être proche d’Amélie, ressentir les choses avec elle, à son niveau, être transporté avec elle afin que tout procède en définitive de sa perception, de sa subjectivité ; donner à voir comment son regard se porte sur les choses et peut les transformer de façon très fluide et naturelle d’une scène à l’autre… Se fixer sur des détails en particulier comme le font les enfants, était vraiment notre fil conducteur. »
Graphiquement le métrage est tout juste magnifique, notamment dans le rendu des surfaces mouillées et de la pluie, la représentation d’une journée à la plage, ou l’agitation effrénée des carpes venant se nourrir à la surface de l’eau. Ajoutez à cela quelques trouvailles de mise en scène, comme l’évocation d’un tremblement de terre depuis l’intérieur d’une salade de riz ou la découverte d’un jardin florissant au fil du passage de l’héroïne. Au final, Amélie et la métaphysique des tubes s’inscrit parmi les plus beaux films récents sur la formation d’une identité propre, la préciosité des souvenirs, notamment d’enfance, et la capacité des blessures à se refermer avec le temps.
Film d’une grande beauté plastique et d’une audace graphique étonnante , on note quelques clins d’œils adressés aux plus grands maîtres japonais, de Hayao Miyazaki à Isao Takahata, ainsi qu’une évocation des impressionnistes , notamment quand il s’agit du rendu des jardins japonais ou d’une cérémonie nocturne en bord de rivière.
Si Stupeurs et tremblements est probablement le livre consacré au Japon et à ses coutumes le plus connu d’Amélie Nothomb, Amélie et la métaphysique des tubes permet d’en découvrir une autre facette, et centré sur la famille, la tradition et le respect de certains héritages.
Amélie et la métaphysique des tubes est le meilleur film qui ait été fait sur l’un de mes livres », confie Amélie Nothomb « C’est vraiment un très, très grand film », commente l’écrivaine, qui a pourtant vu nombre de ses romans adaptés sur grand écran. Stupeur et tremblements par exemple, porté à l’écran par Alain Corneau en 2003, ou Hygiène de l’assassin, devenu un film pour la direction de François Ruggieri en 1999.
Philippe Cabrol
#analysesdefilms #amelienothomb #filmsdanimations