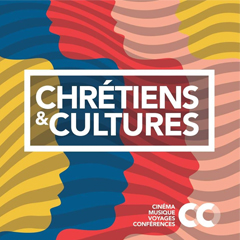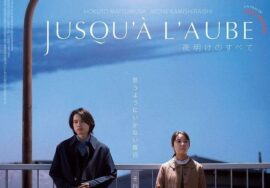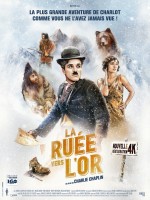
La Ruée vers l’or
Analyse du film : La Ruée vers l’or
Chef-d’œuvre signé Charlie Chaplin, qui emprunte aussi bien au film d’aventures qu’à la comédie sentimentale, « La Ruée vers l’or » ressort en version restaurée 4K le 26 juin 2025, soit 100 ans pile après sa première sortie en 1925, et dans le cadre d’un dispositif exceptionnel (avec plus de 250 projections prévues dans plus de 70 territoires, le tout simultanément).
Il y a eu deux versions de La Ruée vers l’or (The Gold rush). La première date de 1925, la seconde de 1942. Quelle merveille de revoir, 100 ans après sa première projection, l’un des premiers longs métrages avec un Chaplin enfant et adulte, drôle et humain.
La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin, Etats-Unis, 1942, 1h12.
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…
L’idée du film est venue à Chaplin fin 1923 en regardant des images stéréographiques de la ruée vers l’or du Klondike à Pickfair. L’image qui l’intriguait particulièrement montrait une longue file de prospecteurs gravissant le col Chilkoot dans la région de la rivière Klondike, au Yukon. L’inspiration lui est venue également de la lecture d’un livre sur le groupe Donner. En 1846, George Donner et son groupe de pionniers se retrouvèrent bloqués par la neige dans la Sierra Nevada alors qu’ils émigraient en Californie. Les privations étaient telles que beaucoup en vinrent à manger les cadavres, les peaux de vache et les mocassins de leurs camarades tombés au combat. Chaplin était passé maître dans l’art de créer des comédies à partir de thèmes improbables (la pauvreté urbaine dans Easy Street et la Première Guerre mondiale dans Shoulder Arms ).
En 1942, Chaplin a réédité son chef-d’œuvre La ruée vers l’or de 1925 en supprimant les cent quarante et un cartons d’origine et en ajoutant une musique et un commentaire dit par lui-même. Il a doté le film d’une bande sonore composée de sa propre musique et de ses propres effets sonores, les commentaires oraux remplaçant les intertitres originaux. Il a également monté le film et inséré quelques plans supplémentaires pour assurer la continuité. Chaplin a réorganisé certaines séquences et supprimé plusieurs scènes, remodelant ainsi son original de 1925 afin de le « moderniser ». La version muette de La Ruée vers l’or a été reconstituée.
La Ruée vers l’or est son film muet le plus grandiose et le plus ambitieux ; c’est aussi la comédie plus longue et la plus coûteuse jamais produite. Le film contient plusieurs des séquences comiques les plus célèbres de Chaplin, notamment la scène où il fait bouillir et manger sa botte, la danse des rouleaux et la cabane vacillante. Cependant, la superbe qualité de La Ruée vers l’or ne repose pas uniquement sur ses séquences comiques, mais sur le fait que ces scènes soient parfaitement intégrées à un récit centré sur les personnages. Chaplin n’avait aucune réserve quant au résultat final. D’ailleurs, dans la publicité contemporaine pour le film, il aurait déclaré : « C’est le film dont je veux qu’on se souvienne. »
La Ruée vers l’or a un côté épique. Le film présente des aventures grandioses et héroïques, intimement liées par le personnage central de Charlot. Ce héros-clown survit à la cruauté de la nature et à la méchanceté de l’humanité grâce à sa chance, son courage et son esprit d’entreprise. Le thème de Chaplin pour le film est la quête des besoins humains fondamentaux – nourriture, argent, abri, acceptation et amour – dans le contexte hostile de la Ruée vers l’or. Ce n’est pas un hasard si le décor du film reflète le matérialisme des années 1920. Dans La Ruée vers l’or , les êtres humains endurent de grandes épreuves dans leur quête de richesses . Charlot est un paria dans ce désert glacé peuplé d’étrangers. On peut tout à la fois y admirer un portrait juste, féroce et touchant, de l’être humain, une vision crue de ce qu’est le capitalisme et une référence très personnelle à la propre biographie du réalisateur.
L’une des séquences les plus célèbres de Chaplin dans La Ruée vers l’or (et dans tous ses films) montre Charlot, affamé, préparer un dîner de Thanksgiving. Il fait bouillir sa botte et la mange, en ramassant les clous comme des os de poulet, et en faisant tournoyer les lacets autour d’une fourchette avant de les manger comme des spaghettis. L’hilarité délicate de la botte transformée en nourriture est le gag de transposition comique le plus remarquable de Chaplin. Les bottes et les lacets utilisés pour la scène étaient en réglisse et les clous en bonbon dur. Selon l’assistant réalisateur Eddie Sutherland, Chaplin a utilisé 20 paires de bottes en bonbon en trois jours et 63 prises pour terminer la séquence.
Tout aussi célèbre est la séquence de la « danse des petits pains », dans laquelle Charlie plante deux fourchettes dans des petits pains, les transformant en jambes bottées. Chaplin utilise sa tête et le haut de son corps comme s’ils étaient attachés à ses « jambes » en forme de fourchette et exécute avec dextérité une petite chorégraphie.
Le film évoque, par ailleurs, une « Conquête de l’or » qui démonte les mécanismes de la mythique « Conquête de l’Ouest » puisqu’elle est inversée et montrée, non du côté des héros légendaires mais de celui des pauvres, des exclus et des perdants. C’est le rêve américain qui nous est raconté sous forme d’un conte tragi-comique. Mais le rêve est fortement nuancé par des allusions à la solitude, la faim et le froid, la brutalité et la peur, la pauvreté et l’injustice quotidienne. Cette « Conquête de l’or » est montrée, non du côté des héros mais de celui des pauvres, des exclus et des perdants. La ruée vers l’or est, comme souvent chez Chaplin, un film à dimension sociale.
Face à pareil chef-d’œuvre, il reste, brièvement, à souligner l’inventivité, la force et l’efficacité de tous les gags, l’exceptionnel talent d’observation du quotidien, l’originalité d’un onirisme omniprésent qui transfigure la plupart des situations. Il faut signaler, enfin, la symétrie qui donne sa structure au film et fait se répondre certaines scènes : Charlot misérable devant la vitrine du saloon/Charlot milliardaire sur le pont ; Charlot prie le propriétaire pour qu’on le laisse déblayer la neige/le propriétaire à son tour supplie Charlot d’enlever la neige ; Charlot vu comme un poulet par un Jim affamé/Charlot, après avoir enseveli le fusil, frotte ses pieds sur la neige comme le fait un poulet, etc.
Film muet ? Pourtant, la musique a eu une grande histoire pour ce film. Pour Chaplin, un film muet ne devait jamais être muet : dans les grandes salles, des orchestres entiers accompagnaient les images, et même dans les plus modestes cinémas, un piano solitaire animait l’écran. Passionné de musique depuis ses jeunes années sur les scènes anglaises, Chaplin improvisait au violon, au violoncelle et au piano, sans savoir lire une seule note, mais avec une oreille infaillible.
C’est le rêve américain qui nous est raconté sous forme d’un conte tragi-comique. Mais le rêve est fortement nuancé par des allusions à la solitude, la faim et le froid, la brutalité et la peur, la pauvreté et l’injustice quotidienne ; la cruauté des hommes et la dureté de leurs sentiments. Cette « Conquête de l’or » démonte les mécanismes de la mythique « Conquête de l’Ouest » puisqu’elle est inversée et montrée, non du côté des héros légendaires mais de celui des pauvres, des exclus et des perdants. Par contrecoup, Charlot recourt, bien sûr, à l’humour et à la dérision, mais utilise la culture comme exigence de dignité et rempart contre la bestialité.
La Ruée vers l’or était révolutionnaire par son utilisation de la comédie cinématographique pour dépeindre un événement historique dramatique. La ruée vers l’or est avant tout une belle histoire d’amour et d’amitié entre délaissés plein d’espérances. Rarement un film de Chaplin n’aura aussi parfaitement tenu l’équilibre entre comédie et mélodrame. En imaginant son personnage de vagabond pris dans un épisode tragique de l’histoire américaine, il n’omet rien de la dureté de la situation. Mais Chaplin ponctue cette épopée de gags irrésistibles dont certains, comme la danse des petits pains, sont devenus des scènes d’anthologie. Tendresse, suspense, éclats de rire : tout ce qui fait le cinéma est contenu dans ce film.
La Ruée vers l’or a nécessité 17 mois de tournage, dont 235 jours. Le coût total de la production s’est élevé à 923 886,45 dollars, faisant de La Ruée vers l’or la comédie la plus coûteuse de l’ère du cinéma muet. Plus de 70 000 mètres de pellicule ont été exposés.
La Ruée vers l’or est avant tout l’achèvement flamboyant de la première période de Charlot (apparu en 1914), avant que Chaplin ne s’oriente vers un cinéma de plus en plus ample. Son génie a fortement influencé d’autres cinéastes. Que ce soit les gags narratifs, de ceux qui racontent une histoire et s’inscrivent dans le récit et qui ont inspiré Tati, Allen, Lewis, Suleiman ou Étaix. Werner Herzog a rendu hommage à Chaplin en mangeant une chaussure (Werner Herzog Eats His Shoe, 1980). Ou l’image du héros solitaire, poétique et antilibéral, ces marginaux attachants qu’on relie volontiers au cinéma de Keaton, mais qui sont aussi présents dans des blockbusters comme Forrest Gump, Wall-E ou La vie est belle. Et en fil conducteur de toute cette filmographie éclectique, il y a finalement l’humour dans l’adversité, le comique dans le tragique.
La Ruée vers l’or, c’est avant tout un immense succès en salles, le cinquième plus gros box office du cinéma muet aux USA, après Naissance d’une nation (1915), La Grande parade (1925), Ben-Hur (1925), et À travers l’orage (1920). Avec un budget de 925 000 dollars et 4,25 millions de dollars de recettes (environ 74 millions de dollars actuels),
En 1958, un jury de l’exposition universelle de Bruxelles a déclaré La Ruée vers l’or deuxième meilleur film de tous les temps, derrière Le Cuirassé Potemkine. La bataille est engagée. En 2008, les Cahiers du cinéma ont placé plusieurs Chaplin dans la liste des 100 plus grands films de l’histoire : Les Lumières de la ville (17e), Le Dictateur (24e), Monsieur Verdoux (63e), Les Temps modernes (74e), La Ruée vers l’or (97e).
De tous ses films muets, La Ruée vers l’or est considéré comme le meilleur Chaplin et l’un des monuments du cinéma muet dans l’histoire du 7e art, au point de côtoyer les plus grands chefs d’œuvre, toutes nationalités confondues. Charlot affirmera même sa préférence en espérant qu’on se souvienne de lui avec ce film, et pas un autre.
Superbe fable, drôle et poétique et émouvante, le film évoque aussi la destinée de Chaplin – et notamment, sa réussite personnelle née d’un paradoxe (« Je suis devenu riche en jouant un pauvre », disait-il) – en insistant sur les notions de hasard et de chance plus que sur celle de mérite.
Malgré ses guenilles et ses airs d’ahuri, Charlot l’anarchiste est et restera le plus beau héros de l’histoire du cinéma.
Philippe Cabrol
#analysesdefilms #charliechaplin