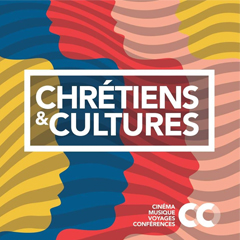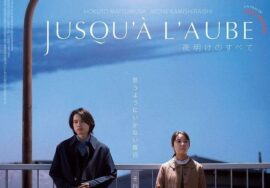Hiver à Sokcho
Analyse du film : Hiver à Sokcho
Sortie en France le 8 janvier 2025 en salle | 1h45min | Drame
De Koya Kamura | Par Stéphane Ly-Cuong, Koya Kamura
Avec : Roschdy Zem, Bella Kim, Park Mi-hyeon
Projeté en clôture de la 19eme édition du Festival Coréen à Paris, Hiver à SOKCHO a été présenté comme un pont entre la France et la Corée du Sud, mais il est surtout un film sur la libération et la réappropriation du corps et de l’âme.
Pour son premier long métrage, le Franco-Japonais Koya Kamura choisit le décor d’une Corée littorale et magnifiquement engourdie par le froid pour composer un film entre bleu gris mélancolique et bruns profonds.
Hiver à Sokcho est une adaptation fidèle par Koya Kamura, un Franco-japonais, du roman d’une Franco-coréenne, tourné dans une petite ville portuaire de Corée du Sud, posée sur la mer du Japon appelée « mer de l’Est, et non loin de la frontière avec celle du Nord.
L’hiver, déserté par les touristes, Sokcho semble hiberner. Et c’est pour trouver cette atmosphère de brume et de mélancolie que le célèbre auteur de bandes dessinées Yann Kerlan s’installe dans une modeste pension. Dans cette petite ville balnéaire Soo-Ha, 23 ans, mène une vie routinière, entre ses visites à sa mère, marchande de poissons, et sa relation avec son petit ami, Jun-oh. L’arrivée du Français, Yan Kerrand, dans la petite pension dans laquelle Soo-Ha travaille, réveille en elle des questions sur sa propre identité et sur son père français dont elle ne sait presque rien. Soo-Ha et Yan Kerrand vont s’observer, se jauger, tenter de communiquer avec leurs propres moyens et tisser un lien fragile.
Yan Kerrand, veut faire ici ce qu’il fait partout ailleurs et ce qui a fait la renommée de son travail : observer, écouter, ressentir et capter l’insaisissable. Yan est un taiseux, un austère, du genre qui ne se lie pas facilement, qui ne se raconte pas, qui ne fait pas semblant d’être ni trop poli, ni trop avenant.
La pension qui va l’héberger est tenue par un veuf et par sa jeune employée SooHa. La jeune fille est franco-coréenne mais ne connaît ni son père, ni la France dont, plus jeune, elle a pourtant rêvé à travers ses études de lettres. Comme Yann elle n’est guère bavarde, comme lui elle n’aime pas faire semblant.
Parce qu’elle parle français et que le patron pense que c’est un excellent moyen pour ses affaires, la jeune femme devient à la fois le guide de cet homme mystérieux qui l’agace autant qu’il la fascine et le guide touristique d’un pays qui extériorise, comme un miroir, sa propre intériorité. Les tours gigantesques qui montent dans la petite ville portuaire peignent ainsi un Sokcho en cours de transformation, de renaissance. En témoigne la visite de la zone démilitarisée puis de son musée où de vieux messages témoignent de familles à jamais séparées.
C’est le début d’une énigmatique et pudique relation entre Soo-Ha, qui rêve de ses origines, et cet artiste voyageur en quête d’inspiration. Mais Yann refuse de se dévoiler. S’il partage du temps avec Sooha, c’est en protégeant son intimité, se refermant brusquement dès qu’il est question de sa famille ou de son histoire personnelle. Son voyage n’est pas un partage mais une captation d’influences, une recherche de moments à « dérober » pour en faire une chronique, un retour d’inspiration. Chaque jour, chaque nuit, il dessine ; chaque nuit, chaque jour, elle essaie de voir ce qu’il dessine. En effet le dessinateur loge dans une petite chambre minuscule, dans l’annexe de la pension. Un trou dans la cloison permet à Sooha d’observer cet homme.
Au gré de leurs échanges, c’est leur vie à chacun qui se lit : celle d’une jeune fille blessée qui, tout en s’en défendant, porte le poids amer de l’abandon et celle d’un homme solitaire qui a si bien dissimulé ses émotions qu’elles ne parviennent plus à briser la distance qu’il a mis entre lui et le monde. En quelques semaines, les malentendus se succèdent ; ils se disputent un peu et, dans un silence particulier, s’observent. Chaque chose qu’ils partagent, chaque moment où une complicité semble s’esquisser, est suivie d’une sorte de repli, de refus obstiné.
Utilisant le symbole de cet entre- deux, d’une guerre qui n’a jamais pris fin, dont des familles séparées souffrent encore, l’auteur évoque celui dans lequel se trouve son personnage féminin, séparé de ce père imaginé, et cherchant inconsciemment dans le comportement du visiteur des réponses à ses questions, voir un lien possible. À l’instar de la Corée, coupée en deux, l’identité de la jeune femme reste morcelée, incomplète et en voie de réunification. Sous le regard de Soo-Ha se dessinent aussi, du côté sud de la frontière, les fondements d’une société des apparences, tant physiques que familiales.
Hiver à Sokcho complexifie cette rencontre entre ces deux personnes que tout oppose en maintenant une part d’ambiguïté dans leur relation. Si Soo-ha, fille d’un ingénieur français qu’elle n’a jamais connu, cherche en Yan un père de substitution, cette connexion se double toutefois d’un soupçon d’érotisme : leur premier contact physique, lorsque Yan prend les mains de Soo-ha entre les siennes pour les réchauffer durant une escapade en montagne, conjugue déjà tendresse et sensualité.
Ce cruel portrait d’une jeune fille qui se sent abandonnée, malgré l’attention de sa mère, vire au drame intimiste dont les sursauts se retrouvent étouffés par la tranquillité des paysages enneigés et l’attitude un peu abrupte de l’étranger. Car tout est raconté à travers ce que la jeune femme pense, de ce qui se joue en elle, de ses choix. Le film montre le voyage parcouru par Sooha, une trame qui la conduit vers une acceptation d’elle-même, jusque dans cette part d’inconnu qui la rattache à la France. Grâce à Yan et son court passage, le fantasme est mis à distance et les nondits sont enfin effacés entre les membres de cette petite famille sud-coréenne.
Hiver à Sokcho montre aussi, au-delà de la barrière linguistique, la mise en place compliquée de la communication entre deux personnes de prime abord opposées.
En effet, si Soo-Ha s’exprime à travers la cuisine, l’écrivain déverse ses idées sur le papier.
Le film se nourrit, outre d’une photographie magnifique, de petites séquences d’animation qui sont un relais entre la profession de Yan et l’histoire qu’il est venu rechercher si loin de chez lui. Dans son film, Koya Kamura a choisi d’insérer des images d’animation réalisées par Agnès Patron. C’est une manière de comprendre ce qui se passe dans la tête de Soo-ha. « Je ne voulais pas passer par une voix off qui peut donner l’impression de quelque chose de déjà digéré et analysé. Je voulais quelque chose de beaucoup plus brut. L’animation permet d’avoir ces élans plus ou moins abstraits au début et de plus en plus figuratifs au cours du film, afin d’avoir un aperçu sur cette intériorité et cette intimité du personnage », dit le réalisateur.
D’un côté, Soo-ha est souvent suivie par des travellings latéraux qui s’accordent aux décors rectilignes dans lesquels elle évolue ; de l’autre les séquences focalisées sur Yan font la part belle à une caméra instable et à des jeux de flous conférant aux paysages les contours abstraits de ses aquarelles.
Qu’est-ce qui forge vraiment notre individualité ? Notre pays, nos parents, notre milieu social, notre métier, notre langue, notre culture ? Hiver à Sokcho pose cette question ouverte et nous invite à réfléchir à qui nous sommes. En nous attachant à ses deux principaux personnages, Koya Kamura dresse le portrait de personnages solitaires et exilés. Ce thème du déracinement constitue le cœur d’un film.
Ce film, qui évoque avec une profonde délicatesse ce voyage entre deux territoires qui s’interrogent, s’interpellent, se tournent autour, est une œuvre feutrée qui avance doucement à petits pas, en demi-teintes, dans la nuance et les non-dits, dessinant à l’encre de Chine l’histoire d’une rencontre entre deux âmes sensibles.
Philippe Cabrol
#analysesdefilms #filmcoréen