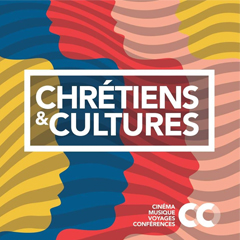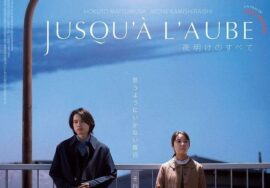La Salle des profs
Analyse du film : La Salle des profs d’Ilker Çatak
Présenté pour la première fois à la Berlinale en 2023, La Salle des profs, quatrième long-métrage du réalisateur allemand Ilker Çatak, à concouru, le dimanche 10 mars 2024, à l’Oscar du meilleur film étranger, aux côtés de Perfect Days de Wim Wenders, La zone d’intérêt de Jonathan Glazer, Moi, capitaine de Matteo Garrone, et Society of the Snow de J.A Bayonaé.
Huis clos dans un collège allemand perturbé par une série de vols, La Salle des profs, a battu des records d’entrées en Allemagne. Multi récompensé dans des festivals, il a remporté cinq Lola, l’équivalent germanique de nos Césars.
Ce thriller scolaire s’inspire d’un souvenir d’enfance du réalisateur, un jour pendant un cours de sciences physiques, des professeurs ont demandé aux filles de sortir de la salle et aux garçons d’ouvrir leur portefeuille et de le poser sur leur table. Deux films français auraient influencé Ilker Çatak, Entre les murs de Laurent Cantet, La loi du marché de Stéphane Brizé et le film belge des frères Dardenne Le jeune Ahmed.
Si les trois précédents films d’İlker Çatak ont été diffusés sur Arte, c’est la première fois qu’il se retrouve en salles en France, après avoir rassemblé 300 000 spectateurs en Allemagne en quelques mois.
La Salle des profs, film de doute, d’humiliation et de pression psychologique passe au crible les informations fallacieuses, la culture de l’annulation, l’emballement médiatique, les jugements approximatifs, tout produisant un sentiment d’injustice.
A la suite d’une série de vols commis dans la salle des professeurs dans un collège, la principale demande aux élèves d’ouvrir leur porte-monnaie. Très choquée par cette méthode Carla Nowak, professeure de mathématiques et d’éducation physique et sportive, laisse volontairement sa veste avec son porte-monnaie dans une poche, face à son ordinateur qui filme pour trouver le voleur.
C’est à travers le point de vue de Carla, professeure investie et soucieuse de ses élèves, que nous voyons chaque question de la classe, chaque interaction avec la hiérarchie. C’est Carla qui est garante de protéger la salle de classe de l’intrusion de cette enquête.
Nombreux sont les films et les documentaires sur l’éducation et les valeurs de civisme ou de vie en collectivité, que l’école transmet. aux enfants La salle des profs, est de ceux qui posent les bonnes questions, au sein d’une intrigue intense, qui ballote cette professeure de bonne volonté, entre vérité et justice, place du bourreau et de la victime. Coincée entre la direction, les professeurs les plus intraitables, ceux qui lui reprochent d’avoir violé le caractère privé de leur lieu de travail, et des élèves qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe, c’est finalement l’hésitation entre affichage et secret qui fera le plus de dégâts.
Caméra sans cesse en mouvement, plans-séquences, image au format 4/3 : le réalisateur maintient une tension permanente : faux coupable, apparences trompeuses, multiplication des points de vue, solitude du héros dans un microcosme hostile… Tous les ingrédients du thriller hitchcockien sont réunis, jusqu’au nom de la professeur de mathématiques, Carla Nowak, clin d’œil à Kim Novak, l’actrice de Vertigo (Sueurs froides) d’Alfred Hitchcock.
La Salle des profs parvient à faire vivre les différents groupes d’un établissement scolaire: les enseignants, les élèves, les parents… chacun tenant son rôle comme dans une micro-société.
Le réalisateur nous montre surtout le degré de cruauté et d’hypocrisie que peut atteindre le système éducatif, dans un pays démocratique et développé comme l’Allemagne. Çatak évoque avec justesse d’autres problèmes susceptibles de survenir au sein de nombreuses écoles, comme le respect de la vie privée, la discrimination des minorités, les brimades, l’autorité professorale, le rôle des parents envahissants et autoritaires, la désinformation, la violence, l’hypocrisie derrière la volonté de bien commun et le travail des enseignants.
Philippe Cabrol
#analysesfilms #salledesprofs #cinema