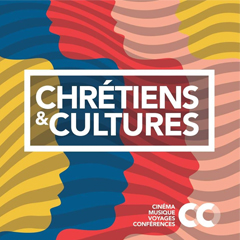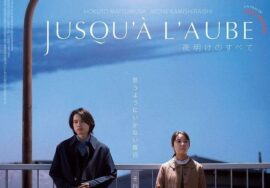Les Chevaux de feu
Analyse du film : Les Chevaux de feu
Sorti en 1965, le chef-d’œuvre “Les Chevaux de feu” a révélé au monde Sergueï Paradjanov. Le film est ressorti en salle ce 18 juin, pour la première fois en version restaurée 4K.
Les Chevaux de feu est un film exceptionnel : un conte immémorial célébrant la communion de l’homme et de la nature ; une histoire d’amour fou, de solitude et de mort ; un tourbillon de musiques, de danses et de couleurs.
Les Chevaux de feu de Sergueï Paradjanov, 1964, Russie, 1h40.
Avec : Ivan Mikolaitchouk, Larissa Kadochnikova, Tatiana Bestaïeva, Nikolaï Grinko, Leonid Engibarov, Spartak Bagachvili
Les Ombres des ancêtres disparus, titre original du film, est une adaptation, réalisée en 1965, d’une nouvelle de l’écrivain ukrainien Mykhaïlo Kotsioubynsky. L’action se situe dans un village houtsoul, dans les Carpates ukrainiennes, à une époque inconnue.
Un jour, après la messe, le père du jeune Ivan se bat avec un homme qui le tue. Le sang envahit l’écran, ainsi que l’ombre de chevaux rouges au galop. Ivan se lie avec Maritchka, la fille de l’homme qui a tué son père. Leurs enfants, Ivan et Marichka s’aiment. Devenus adultes, les deux amoureux décident de se marier, malgré la haine des deux familles. Mais Ivan doit d’abord aller travailler à l’alpage et demande à Maritchka de l’attendre. Un jour, celle-ci, qui garde des moutons, tente de sauver un agneau. Malheureusement, elle tombe dans un torrent et se noie. Ivan devient très solitaire, bourru et malade. Il erre sans fin dans la montagne à la recherche de sa bien-aimée. Au printemps, la sève et les fleurs revenues, il prend pour femme la sensuelle Palagna. Mais leur union, demeurée stérile, sera un échec. Cruellement blessé par un sorcier devenu l’amant de Palagna, Ivan rejoint enfin Marichka au royaume des morts.
A partir de cette histoire simple et banale Parajanov nous offre un torrent d’images d’une stupéfiante beauté. La caméra court sans cesse aux côtés d’Ivan et de Marichka, avide de ne rien perdre de l’amour qu’ils irradient avant que la mort ne les fige pour l’éternité. C’est une course haletante pour saisir au vol toutes les manifestations de la vie, un regard, le frôlement de deux peaux, un sourire, un pas de danse, la fuite de quelque animal, dans le ciel, dans la forêt où les arbres, les fleurs, le soleil, la le tonnerre, la pluie et le vent vent, comme autant de thèmes majeurs d’une panthéiste symphonie du monde composée par Paradjanov à la gloire de la nature, de l’amour et de l’homme.
Dans Les Chevaux de feu, la nature est plus puissante que l’homme, plus forte que l’amour. Paradjanov raconte son histoire avec des intuitions de peintre (ce qu’il était), en investissant les couleurs d’un rôle précis : le vert est ici la couleur de la forêt, qui tour à tour protège et sépare Ivan et Marichka. Le vert est puissant et les humains qui possèdent suffisamment de force vitale pour le commander, comme Palagna et le sorcier Youra, peuvent lui résister et en tirer parti, le faire virer au jaune. Mais pas Ivan, qui a perdu le goût de vivre après la mort de Maritchka. Le rouge est la couleur du sang et de la mort : la couleur de ces chevaux de feu qui traversent l’écran lorsque le père meurt et que le sang se répand à même la pellicule ; la couleur des baies que mange Maritchka, la couleur que prend l’écran après la mort de Maritchka ; la couleur de ces arbres qui marquent l’entrée du monde des morts. Le bleu représente le monde de l’eau, le monde du torrent : c’est un monde ennemi et mystérieux. Ce bleu n’est pas d’azur, il est embrumé et ensorcelé. Enfin, il y a ces plans en noir et blanc quand Ivan est au désespoir.
Ces images, ces couleurs, sont portées par la musique traditionnelle des Houtsoules où dominent les chœurs d’enfants (Emir Kusturica emprunta beaucoup à ce film ). C’est l’expression d’une culture de musique et de danse où les mouvements des hommes et des femmes épousent le rythme des saisons, où le temps de la vie est accordée au rythme de la nature, où des voix sanglantes chantent des passions malheureuses. Une culture où le temps est cyclique et où la mort fait partie de la vie. Cela, Ivan l’a oublié ou l’a refusé par amour pour Maritchka. Mais pas les autres Houtsoules : c’est pourquoi ils rient, oublient leur malheur, malgré la mort de l’un des leurs. c’est une farandole de couleurs (des blancs, des bruns, des jaunes, des verts, des bleus mêlés) qui illumine l’écran (vêtements, tapis, masques, sculptures, peintures, architecture, prairies, forêts, montagnes).
Le réalisateur s’attarde longuement aux coutumes et cérémonies d’une région de l’Ukraine qu’il présente dans une aura légendaire, mais aussi dans un style tout à fait moderne. La photographie est soignée à l’extrême et la musique s’unit aux images pour créer un rythme envoûtant d’un lyrisme presque palpable. Ukraine qu’il présente dans une aura légendaire, mais aussi dans un style tout à fait moderne. La photographie est soignée à l’extrême et la musique s’unit aux images pour créer un rythme envoûtant d’un lyrisme presque palpable.
Ce qui frappe dans le film de Paradjanov, c’est combien la nature est associée aux hommes, en ce sens elle est utilisée par le réalisateur pour exprimer les sentiments que ressentent les protagonistes et elle semble s’accorder à leurs passions : les chevaux (qui a donné son titre au film) qui traduisent la violence entre les hommes, la pluie qu’accompagne les larmes de Maritchka, quand elle perd Ivan qui s’en va passer l’été sur l’alpage ; une étoile au sommet de la montagne, que tous deux pourront voir en même temps malgré leur séparation. La solitude d’Ivan sur l’alpage est représentée par des gros plans de minéraux impassibles, de mousses ou de lichens, l’eau où Ivan cherche en vain le reflet de Maritchka, plus tard, après la mort de Maritchka, une biche qui rode près de sa tombe, et qu’Ivan cherche à saisir symbolise l’absente que pleure le jeune homme L’arbre est omniprésent dans ce pays de bergers et de bûcherons : le destin tragique qui attend Ivan est préfiguré au début du film par cet arbre qui en tombant écrase son frère aîné Olekso, alors qu’il venait lui apporter à manger ; quand, redescendu de l’alpage, il part à la recherche du corps de Maritchka, c’est un radeau fait de troncs assemblés qui l’emporte, où il s’étend les bras écartés ; c’est sur un arbre que grimpe Ivan pour croquer une pomme avant d’épouser Palagna. Ivan croit retrouver Maritchka, transformée en mavka, ces esprits de la forêt qui sont les âmes des jeunes filles décédées de mort tragique : les mains tendues de Maritchka/mavka vers Ivan pour l’enlever sont semblables à des branches d’arbre. Ivan en meurt, mais au lieu de représenter sa mort Paradjanov montre à l’écran d’étranges branches d’arbres rouges entremêlées. La vision mystérieuse de la nature semble à chaque fois remplacer les mots des hommes.
Les Chevaux de feu est ainsi un film profondément symbolique.
La mort est omniprésente : de la famille d’Ivan (ses cinq frères et sœurs) il ne reste bientôt plus que lui avec sa mère ; Maritchka meurt ; Ivan lui-même lors d’une danse des masques porte celui de la Mort avec sa faux ; il meurt et la vision de son cadavre clôt le film.
Paradjanov a accentué le primitivisme de la société houtsoule par des musiques étranges (à la guimbarde, au chalumeau, au trembita qui est une longue corne alpine en bois très spectaculaire et à la sonorité funèbre), des danses traditionnelles lors de fêtes villageoises qui font penser à celles peintes au XVIe siècle par Pieter Brueghel l’Ancien. L’empreinte du christianisme dans la société villageoise est fortement présente (toutes et tous passent leur temps à se signer, à prier,… ), mais à côté subsiste pourtant un très ancien fond païen avec tout un cortège d’esprits de la forêt, de sorciers et de sorcières. Paradjanov n’hésite pas à forcer le trait « primitiviste », par exemple quand il invente un rite étrange : celui d’attacher les époux – Ivan et Palagna – au joug le jour de leur mariage.
Ce qui intéresse le cinéaste, c’est de faire « un film sur les passions intelligibles à tout être humain ». Ainsi, par-delà des enjeux purement esthétiques, Paradjanov propose une anthropologie des passions d’une population montagnarde ukrainienne, les Houtsoules (ou Goutzoules).
Le film est découpé en douze chapitres (équivalents aux mois de l’année) scandés par des cartons en lettres cyrilliques rouges sur fond noir. Seul le titre du dernier chapitre (intitulé « Piéta ») détonne par l’usage de lettres latines blanches sur fond noir. Pour autant, pendant les onze précédents chapitres, à l’intérieur de chacun d’eux, c’est le rouge qui s’immisce. La contamination progressive, qui passe de l’orange au rouge, rappelle au spectateur non seulement le sang et la mort mais également la vie, c’est-à-dire le sentiment passionnel des personnages. Quand la mort arrive, dès l’assassinat du père d’Ivan, c’est une pluie sanguinaire qui jaillit sur l’écran avec, en surimpression, l’arrivée des chevaux de feu qui se dressent comme pour alerter de l’imminence de la mort. Quant à Ivan, n’arrivant pas à faire son deuil, ses proches affirment qu’« il n’a plus rien d’humain ». Ivan n’arrive pas à concilier les trois stades de l’existence que décrit Kierkegaard, c’est-à-dire : ni le stade esthétique qui consiste à vivre dans l’instant des passions et des désirs à assouvir, ce qui mène Ivan à la dépression et au désespoir, ni le deuxième stade éthique qui consiste à s’engager pour surpasser le désespoir, ni le dernier stade religieux qui consiste en la foi et l’espérance.
Construit par un effet de symétrie (entre Maritchka et Palagna), mais aussi de triptyque (la mort du père au début, la mort de l’aimée et la mort d’Ivan), et enfin par un rappel constant à la peinture historique de Brueghel l’Ancien, Les Chevaux de feu est le film qui permet à Paradjanov de remplir le rôle de chef de file d’un cinéma novateur et figuratif à la recherche d’une nouvelle esthétique que l’on retrouve chez Pasolini (lequel possède le même goût pour représenter les mœurs des civilisations disparues) ou encore chez Godard ou Varda (pour les couleurs et le soin apporté à l’étude anthropologique). Avec ce film aux accents de tourbillon baroque, il rompt avec les codes soviétiques, du réalisme et du socialisme de l’époque. Si Paradjanov se méfie des dogmes religieux, il se définit bien comme un mystique. La magie, le sacré, hantent constamment son cinéma.
Étymologiquement, le mot passion renvoie à la souffrance, et on comprend, avec Paradjanov, que toute passion est déçue puisque dès que l’aimée disparaît c’est le début du déclin pour Ivan.
Sergueï Paradjanov (1924-1990) a étudié le chant et la peinture avant d’apprendre le cinéma auprès d’Alexandre Dovjenko, le poète de La terre (1930). Farouchement indépendant, privilégiant la forme sur le fond, défenseur résolu des cultures traditionnelles, il fut réprouvé par les autorités soviétiques l’internèrent plusieurs années en camp de travail. Ainsi ce film a eu beaucoup de difficultés à être terminé, ce qui explique la présence de longues séquences en Noir et Blanc, Parajanov n’ayant pas eu un accès aux pellicules couleurs. La photographie est soignée à l’extrême.
À contre-courant du cinéma soviétique officiel de l’époque, Paradjanov signe ici un des chefs-d’œuvre cinématographiques du XXe siècle, qui stupéfie toujours par sa modernité. Ce qui fait la force de ce film, ce sont ses mouvements de caméra déjantés, tordus en tous sens, s’enchaînant avec une rapidité folle. Ce travail sur l’image est à mettre au crédit du chef opérateur du film, Youri Illienko. Il faut signaler aussi que le réalisateur, dans la scène du meurtre du père, n’hésite pas à ensanglanter l’objectif de la caméra.
L’histoire de ce cinéaste surprend et fascine : son impétuosité, sa volonté, son courage, sa révolte, son insoumission contre un système corrompu. Avec ce film, en 1965, Sergueï Paradjanov rompt avec les codes du cinéma réaliste et socialiste de l’époque. Ce « clown triste de la Perestroïka », comme il aime s’appeler, a longtemps été harcelé par le régime en vigueur, passant un grand nombre d’années derrière les barreaux, suspecté d’anti-soviétisme, victime de calomnies, de diffamations, envoyé dans des camps de redressements au « régime sévère ». Beaucoup vont le défendre. Et rien ne va l’empêcher d’aimer courageusement le cinéma, de vouloir en vivre, tout en revendiquant sa liberté. Il prend parti contre le pouvoir en place, soutient les intellectuels de son pays, signe des pétitions adressées à la Troïka. À 64 ans, seulement, il peut sortir de l’ex-URSS pour présenter un de ses courts-métrages à Rotterdam. La vie de faste commence, mais déjà un brin de folie et un souffle de maladie viennent ternir son image. Il ne faut pourtant pas oublier que ce charmant provocateur a vu sa première femme assassinée par sa propre famille, et surtout que, pendant quinze ans, le régime soviétique l’a empêché de toucher à une caméra.
Philippe Cabrol
#analysesdefilms