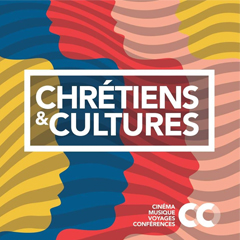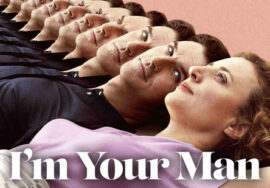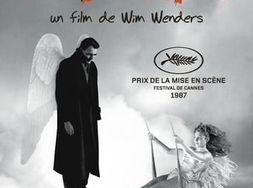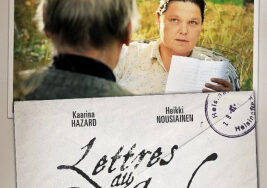2001, L’Odyssée de l’espace
L’homme face au mystère de l’univers
Film américano-britannique ; Réalisation : Stanley Kubrick
Avec : Keir Dullea (Dave Bowman), Gary Lockwood (Frank Poole), William Sylvester (Heywood R Floyd)
Scénario et dialogues : Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke
Durée : 149 minutes ; Date de sortie : 1968 ; Genre : science-fiction
Prix : Nommé quatre fois aux Oscars
Il y a presque cinquante ans, Stanley Kubrick envoyait l’homme sur Jupiter dans son œuvre devenue culte, 2001 : l’odyssée de l’espace, signant l’un des plus grands films d’anticipation de l’histoire du cinéma. À bien des égards ce film reste une énigme. « Si vous comprenez 2001 : l’odyssée de l’espace, c’est que nous avons échoué, notre but étant de soulever davantage de questions que d’y répondre », disait le britannique Arthur C. Clarke, co-auteur avec Kubrick du scénario. Quand il sort en 1968, la course vers la lune bat son plein : Neil Armstrong et Buzz Aldrin fouleront son sol un an plus tard…
2001 : l’odyssée de l’espace est construit en quatre parties. La première plonge le spectateur aux débuts de l’humanité : un groupe de singes végétariens, menacé par des voisins carnivores, découvre un monolithe noir et mystérieux. L’un d’eux apprend à se servir d’un os comme d’une arme et tue pour se procurer de la viande. Le deuxième acte se déroule quatre millions d’années plus tard… En 2001, un savant américain, le docteur Floyd, se dirige vers la lune pour enquêter sur la présence d’un monolithe noir qui émet des signes vers Jupiter. La troisième partie se déroule dans un vaisseau spatial, Discovery, en voyage vers Jupiter. À bord se trouvent David Bowman et Frank Poole, À bord se trouvent David Bowman et Frank Poole, ainsi quetrois cosmonautes en hibernation et l’ordinateur HAL 9000 qui contrôle l’astronef. HAL annonce une panne d’une antenne extérieure. Poole sort pour la réparer et découvre que l’information est fausse, mais HAL coupe son lien avec le vaisseau, l’abandonne dans l’espace et met fin aux fonctions vitales des trois cosmonautes en hibernation. Bowman, parti sauver son ami, revient dans le vaisseau pour « lobotomiser » HAL. Dernier acte du film : Bowman, seul survivant, continue son vol et rencontre le monolithe près de Jupiter. Il entre dans un nouvel espace-temps : il se retrouve dans une chambre du XVIIIe siècle, se voit vieillir, aperçoit à nouveau le monolithe et renaît, « fœtus astral » flottant au-dessus de la Terre.
L’inspiration nietzschéenne
Le film de Kubrick nous montre trois évolutions de l’Homme : l’homme-singe, l’homme rationnel de l’espace et le « fœtus astral ». Elles nous renvoient aux trois métamorphoses que Nietzsche décrit dans Ainsi parlait Zarathoustra qui symbolisent les étapes de la conscience humaine. L’homme-singe qui découvre le monolithe noir et le manipule avec respect, se caractérise par son instinct. Il se rapproche du chameau de Nietzsche. Déférent envers Dieu, il subit sa vie. L’astronaute représente la deuxième évolution de l’homme, avec son côté rationnel. Il renonce symboliquement à la présence de Dieu en confiant sa vie à HAL, une intelligence artificielle. Il rappelle le lion du philosophe allemand qui bat le dragon, c’est-à-dire Dieu, et qui se libère de toutes contraintes. La dernière étape est celle du surhomme représenté par le « fœtus astral ». Ce nouvel être est l’expression d’un éternel retour, d’un commencement à chaque fois différent.
L’homme, l’outil et la machine
Le film décrit aussi l’évolution du rapport de l’homme à la technique. Le monolithe apparaît d’abord comme un signe d’espoir : le singe s’en approche puis découvre l’usage de l’os comme arme, premier pas d’une domination technique du monde. Cette dalle mystérieuse réapparaît sur la lune lorsque l’homme est menacé par les machines. Ce monde est pour Kubrick la limite de l’homme scientifique et technique. L’ordinateur HAL, en proie à la peur de mourir, se révolte contre sa mission puis se venge de ceux qui se méfient de lui en se déconnectant des trois astronautes. Ainsi, l’homme dépasse le stade animal par le moyen de la technologie : de l’os aux vaisseaux spatiaux en passant par les ordinateurs, il atteint le stade du surhomme en se délivrant de la technologie.
La force du film est de confronter notre civilisation à une autre en préservant le mystère de cette rencontre. La structure en quatre parties est rigoureusement respectée : quatre apparitions du monolithe, quatre héros (singe, savant, ordinateur, fœtus) mais surtout des thèmes récurrents comme la nourriture (repas des singes d’abord végétarien puis carnivore, repas de Floyd dans des sachets plastiques, repas dans Discovery, dernier repas de Bowman)…
L’utilisation de la musique
Le film s’ouvre sur un écran noir puis nous entrons dans la lumière du soleil en entendant un poème symphonique grandiose. Kubrick a fait le choix de n’utiliser que des morceaux de musique classique. Le thème de Richard Strauss évoque l’énigme de l’univers et introduit, par une ligne ascendante de trois notes do-sol-do, le chiffre trois que l’on retrouve dans la présence de trois sphères après le générique : la lune, la Terre et le soleil. Le Requiem et Lux Aeterna de Ligeti sont utilisés dans les séquences les plus mystérieuses. L’ellipse qui nous fait faire un bond de plus de quatre millions d’années en deux plans, est représentée par un os lancé en l’air par un singe. Au plan suivant, cet os se transforme en vaisseau spatial avec la musique du Beau Danube bleu de Strauss et reste la scène la plus connue. N’oublions pas aussi Gayaneh du compositeur arménien Aram Khatchaturian qui accompagne la vie des cosmonautes dans Discovery.
2001 : l’odyssée de l’espaceest sorti sur les écrans un an avant la réussite de l’expédition Apollo13 et fut interprété comme la célébration de la conquête spatiale américaine. De quoi attiser l’envie des Soviétiques… En 1971 ces derniers commandent à Andreï Tarkoski Solaris, un film tout autant métaphysique mais bien éloigné de l’idéologie de 2001...
Pistes pédagogiques
– Relire les différentes étapes du film. Relever les séquences les plus énigmatiques.
– L’homme est filmé sous deux aspects, le créateur et le destructeur. Analyser ces deux aspects.
– Le monolithe intervient trois fois dans le récit mis en scène par Kubrick. Quelle importance revêt-il à chaque étape ? Quelles explications en donner ?
– Quelle place donne Kubrick à la science et à la technique ?
– Comment interpréter la dernière partie du film où l’être humain est confronté à sa propre mort ?
– Au-delà du film, comment envisagez-vous les relations entre science et foi ?
Philippe Cabrol