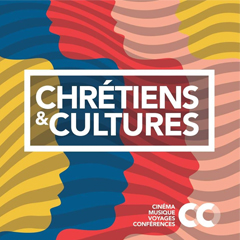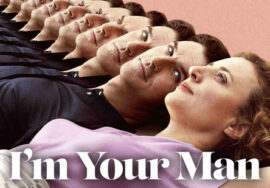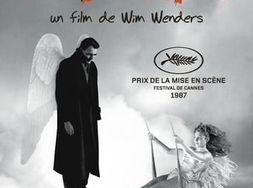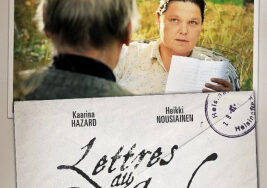Une vie cachée
« Une vie cachée » de Terence Malick a obtenu le prix du jury œcuménique au dernier festival de Cannes. Ce film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et s’appuie sur les lettres écrites par l’objecteur de conscience Franz Jägerstätter, fermier autrichien qui refuse de prendre les armes, de signer le serment d’obéissance inconditionnelle à Hitler et de combattre au service du IIIe Reich. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il risque de la peine capitale.
Comme souvent chez Malick, le film débute dans une ambiance paisible, mettant en lumière la nature, dans de somptueux paysages montagnards. Et c’est donc dans cette paix apparente, que le cinéaste nous invite, avant de découvrir une réalité toute autre.
Dès le début du film nous sommes transportés dans un petit village autrichien où les paysans vivent simplement et authentiquement. Franz, sa femme Fani et leurs trois filles mènent une vie heureuse, remplie de joie, d’amour et de prières. Ils vivent en harmonie avec la nature, travaillent les champs, fauchent les blés enterrent les plants de pommes de terre, récoltent des betteraves…Mais Franz doit partir en 1939 faire ses classes. De retour dans son village, Franz manifeste ouvertement son rejet d’Hitler. Minoritaire, non compris, il est banni par les habitants de son village Tourmenté, Franz se tourne vers l’Église catholique qui lui demande la soumission. S’engage alors un long combat spirituel dans lequel il est soutenu par son épouse. Grâce à sa foi et son amour pour Fani, Franz vit « un chemin de croix » et traverse cette épreuve, qui ressemble à la Passion, dans la prière.
La spiritualité est présente dans Une Vie Cachée, ainsi que la foi dans la capacité à maintenir et à soutenir ses convictions malgré l’adversité, à rester un face à l’immensité, sans jamais trembler. L’évolution du personnage de Franz va dans ce sens, partant de la conformité au régime nazi, pour passer par l’indignation, l’injustice, l’affirmation, et, enfin, la résignation. C’est la quête d’une forme de pureté, que l’on ressent dans l’esthétique du film, mais aussi dans le personnage de Franz, qui cherche une véritable pureté, l’intégrité, autre que celle prônée par les nazis. A ce sujet, Malick examine toutes les institutions, qu’elles soient politiques (le maire), religieuses (le prêtre) ou militaires (le juge du tribunal militaire), pour s’interroger sur leurs finalités et leur capacité à comprendre la volonté d’un homme de suivre ses convictions personnelles.
Franz apparaît comme une figure christique à travers son mariage avec Fani. Leur alliance se vit àde l’amour du Christ et de l’Eglise, dans les moments de fête, de travail, durant leur long chemin de croix. Leurs merveilleuses lettres en sont les témoins et la mémoire. La figure christique de Franz se lit aussi dans la splendeur de la nature et dans le beau. On retrouve la figure christique de Franz dans les traits de caractère et les vertus qu’il partage avec Jésus de Nazareth : on le voit bien dans le film à travers les béatitudes (cf. Mt 5,3-12) : doux et humbles de cœur, familiers de la prière, intimement animés par l’amour de la vie et des personnes, sans ruse ni mensonge. Franz ressemble encore au Christ à travers son comportement en prison. Résistant aux tentatives de déshumanisation, il donne son morceau de pain à quelqu’un qui en a plus besoin que lui. Face à ses bourreaux, il ne répond jamais au mal par le mal. Humilié, torturé, il s’en remet à Dieu qui semble parfois bien silencieux. Il s’en remet également aux souvenirs de sa vie avec son épouse et ses enfants. Son sacrement de mariage contribue ainsi à lui donner inspiration et force.
Isolé, marginalisé, rejeté, Franz s’en remet à Dieu, lui parle, incrédule face à son silence. Emprisonné, humilié, avili, torturé, Franz ne dévie pas de sa ligne de conduite. Sous les insultes de ses voisins, les aboiements des nazis, et la perspective de la peine capitale, il oppose, sans un mot, son inflexible droiture à l’injonction violente de se renier. Du fond de sa solitude, il se parle à lui-même, correspond avec Fani, lettres d’amour magnifiques de simplicité.
Une vie cachée est une magnifique allégorie. Malick voit clairement la vie de Jägerstätter et celle de ceux qui l’entourent comme des exemples de ce qui se passe lorsqu’une idéologie de haine et de nationalisme fervent plante un enjeu dans une communauté, et comment les croyants sont appelés à s’y opposer et à lutter pour le faire.
Une vie cachée peut alors être vu comme une longue prière, et plus encore comme une invocation, l’appel déchirant d’un homme qui lutte pour préserver son humanité intactealors que le monde autour de lui plonge plus profondément dans le mal.
Chemin de croix et Passion d’un homme déchiré entre la tentation de céder pour protéger les siens et la constance de sa conviction, Une vie cachée est un film stupéfiant de beauté et d’intériorité, habité par la grâce.
Franz Jägerstätter (1907-1943) a été béatifié en octobre 2007 par Benoît XVI. Terence Malick n’en fait pas mention dans son film, cependant dans le générique de fin il cite un extrait du Middlemarch de George Eliot sur «ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes que personne ne visite plus».
Commentaire du président du Jury œcuménique 2019, le pasteur Roland Kauffmann
L’histoire de Franz Jägerstätter, un fermier autrichien, qui, avec le soutien de son épouse Fani, refuse de prêter allégeance à Hitler, met en scène un profond dilemme. La haute qualité cinématographique, en termes de réalisation, de scénario et de montage, permet d’exprimer et d’explorer les questions qui se posent à la personne confrontée au mal. C’est un récit universel à propos des choix que nous avons à faire et qui transcendent les préoccupations terrestres pour suivre la voix de sa conscience.
Le choix du jury œcuménique s’est porté sur un film somptueux mettant en scène la vie ordinaire et véridique d’un objecteur de conscience autrichien qui loin de vouloir être un héros le devient cependant à son corps défendant. Enrolé en mars 1943, il refuse de prêter le serment d’obéissance indéfectible à Hitler, requis de tout soldat de la Wehrmacht, il est emprisonné, battu, jugé et finalement exécuté le 9 août de la même année.
Par ce choix, le jury œcuménique met en valeur un « héros ordinaire », à la manière dont le théologien américain Ralph Waldo Emerson parlait de « Sublime ordinaire » pour évoquer la façon que Dieu a de se manifester dans les choses les plus simples de l’existence alors même qu’il s’agit comme ici des circonstances extraordinaires de la guerre.
« On peut être un héros sans ravager la terre » (Boileau).
C’est dans le secret de sa conscience et dans l’amour de son épouse, Fani, que Franz va trouver la force de résister. Le réalisateur n’en fait ni un martyr ni un héros au sens traditionnel du terme. Il raconte le lent cheminement, les doutes et les hésitations, qui contribuent à la décision. Et surtout Franz ne prétend en aucune manière juger ni détenir une révélation particulière voire une connaissance spéciale de ce qui est bien ou ce qui est mal. Franz n’agit qu’en cohérence avec sa foi, convaincu qu’il est qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes et qu’il ne faut pas ajouter de l’injustice là où elle est déjà surabondante.
Somptueux, le film l’est d’abord par sa réalisation. Comme à son habitude, Terrence Malick filme la nature dans toute sa beauté et son immensité au point que le moindre brin d’herbe devient un monde à lui tout seul. Dans cette nature généreuse d’une vallée du Haut-Tyrol, Franz et Fani cultivent leur terre en bonne intelligence avec leurs voisins.
Sa décision est celle d’un instant ! Ce moment précis du serment qu’il refuse de faire est traité dans le film pour ce qu’il est, une courte séquence qui fait basculer Franz dans le monde gris et terne, sale et bruyant des prisons et des tribunaux. La correspondance avec son épouse, Fani, qui a servi de base pour le scénario, les efforts de celle-ci pour sa libération, la haine des villageois envers celui qu’ils considèrent désormais comme un traître, les difficultés de sa famille juste à assurer leur subsistance, tout cela est en contre-point avec la première partie du film.
Mais cet instant est nourri de tout ce qui l’a précédé, de cette terre que Franz et Fani travaillent, de ces jeux avec leurs enfants, de ces moments de tendresse. C’est au nom de tout cela que Franz prend sa décision, sachant pertinemment qu’il va tout perdre, même la vie, justement pour ne pas sombrer dans la barbarie.
« Je ne juge personne, chacun sait pourquoi il fait ce qu’il fait »
Terrence Malick ne livre pas un film à thèse, assénant une vérité incontestable. Ses héros, Franz et Fani, ne sont pas des blocs de certitudes mais de chair et de sang. Faisant simplement ce qu’ils pensent être juste, sans jamais en vouloir à ceux qui les tiennent en leur pouvoir, ils atteignent la liberté malgré les barreaux, les coups, les menaces et la haine sans jamais se laisser atteindre par la haine en retour.
Quelques éléments historiques pour situer l’histoire d’Une vie cachée
Franz Jägerstätter (1907-1943) est un fermier et père de famille autrichien qui a sacrifié sa vie pour ne pas servir l’« idéologie satanique et païenne » du Nazisme. Il est allé à l’encontre de sa communauté et de presque toute sa nation, alors que même son Église locale n’a pas offert beaucoup de secours. Pourtant Jägerstätter, face à une opposition presque totale, persista dans sa fidélité solitaire à l’Évangile.
Les événements de 1938 marquent le point culminant des pressions de l’Allemagne et des nazis autrichiens pour unifier les populations allemandes et autrichiennes au sein d’une même nation. Les troupes de la Wehrmacht entrent en Autriche le 12 mars 1938 pour mettre en œuvre l’annexion, sans rencontrer la moindre opposition.
En février 1943, Jägerstätter fut enrôlé dans la Wehrmacht. Quelques jours après son refus, il a été emprisonné. Jägerstätter a eu amplement l’occasion de changer d’avis, mais plus il lisait la Bible et plus il approfondissait sa foi, plus il était révulsé par le nazisme et plus il continuait donc à refuser de s’engager dans l’armée. Il a proposé de servir comme ambulancier paramédical sur le front, mais cette demande a été rejetée. En juillet, il fut condamné à mort et dans l’après-midi du 9 août 1943, il fut décapité à la prison de Brandenburg-Görden. Il avait 36 ans.
Pistes pédagogiques
Ces pistes sont des propositions. L’objectif n’est pas de traiter toutes les pistes, mais de choisir celles qui s’apparentent le mieux au ou aux thème(s) choisi(s).
- Le film débute dans une ambiance paisible, mettant en lumière la nature, dans de somptueux paysages montagnards. Montrez qu’à travers la contemplation de la nature, les travaux dans les champs et la voix off, Terence Malick nous convie à louer la création.
- Ce film secoue, interpelle, ne laisse pas indifférent… Exprimez vos réactions, vos interrogations. Indiquez les scènes, les images, les musiques, les paroles qui vont ont marqué.
- A partir de scènes et de phrases fortes du film, analysez la grandeur d’âme et l’héroisme de Franz.
- Comment réagissez-vous à la manière de Terrence Malick de confronter bien et mal ?
- Comment voyez-vous le mal dans le récit ? Où se situe-t-il ?
- Que signifie la décision de Franz ? Quelle valeur a-t-elle si elle est sans portée politique ? Qu’implique-t-elle comme mal fait aux proches ? Est-ce de la résistance ou de l’orgueil ?
- Crois-tu que cela serve à quelqu’un ? » : cette question est posée à Franz quand il est en prison. Comment réagissez-vous à cette question ?
- « Une vie cachée « est une ode à l’amour et à la foi. La tendresse qui émane du couple formé par Franz et Fani s’inscrit dans la lumière, l’espérance et non le désespoir. Comment le justifiez- vous ?
- Du fond de sa solitude, il se parle à lui-même, correspond avec Fani, lettres d’amour magnifiques de simplicité ; relevez des exemples flagrants.
- Le personnage de Franz va passer par l’indignation, l’injustice, l’affirmation, et finalement, la résignation. Montrez comment Terence Malick va progressivement à travers ce film se centrer sur l’intime et la conscience de Franz. Comment comprenez-vous la démarche de Franz ? Y-a- t-il, pour vous, dans sa démarche, une forme de sacrifice ? Si c’est le cas, pouvez-vous l’expliquer ? Que vit Fani, son épouse ? N’est- ce pas aussi une autre forme de sacrifice ? Argumentez.
- « Une Vie Cachée n’est pas un film où le mal est identifié rapidement, et où le droit se dresse immédiatement contre lui. C’est un film qui ressemble davantage à ce à quoi vivre avec le mal ressemble… C’est beaucoup plus subtil, et le film exprime bien le doute et le choc qui assaille celui qui réalise que des gens qu’il croyait bien connaître, puissent héberger une telle haine, ou être si passifs. » écrit Jean-Luc GADREAU, Pasteur au sein de la Fédération baptiste de France. Comment voyez-vous le mal dans ce film ? Ou se situe le mal et comment ? Comment vous à la Terrence Malick confronte-t-il le bien et le mal ?
- Voici quelques phrases fortes dites par Franz dans le film : « Si Dieu nous donne le libre arbitre, on est responsable de ce qu’on fait. Ou ne fait pas. Non ? » « Les gens ne reconnaissent-ils pas le mal quand ils le voient ? » « On tue des innocents. On envahit d’autres pays. On s’attaque aux faibles. Les prêtres érigent en héros, en saints, les soldats qui font ça. » « Mieux vaut subir l’injustice que la commettre. » « Ai-je le droit de ne pas faire ce qui est juste ? » « Je ne peux pas faire ce que je crois être mal. » Que pensez-vous de ces phrases ? Justifiez.
- On a écrit sur « Une vie cachée » : C’est une prière qui se tourne inlassablement vers Dieu… prière que fait aussi Fani avec une sincérité bouleversante, même quand les doutes s’immiscent. Qu’apporte la prière à Fani et à Franz ? Y-at-il une réponse à leurs prières ? Qu’en pensez-vous ? Que veut nous dire Terence Malick ? « Entendre Dieu » – De quelle façon cette expression résonne-t-elle en vous ?
- Dans « Soi-même comme un autre », Paul Ricœur propose une définition de l’éthique en trois termes : « le souhait d’une vie accomplie – avec et pour les autres – dans des institutions justes ». Par rapport à cette pensée de Ricoeur, pensez-vous que la décision de Franz relève de l’éthique ? Si oui, Pour quelles raisons ? A propos de l’éthique, le sociologue allemand Max Weber distingue l’ « éthique de la conviction » et l’ « éthique de la responsabilité », dans « Le savant et le politique ». Pour Weber, le propos n’est pas de dégager une éthique unique – encore moins une morale à vocation universelle –, mais une éthique propre à une activité liée à sa finalité intrinsèque…
« Nous en arrivons ainsi au problème décisif. Il est indispensable que nous nous rendions clairement compte du fait suivant : toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées. Elle peut s’orienter selon l’éthique de la responsabilité ou selon l’éthique de la conviction. Cela ne veut pas dire que l’éthique de conviction est identique à l’absence de responsabilité et l’éthique de responsabilité à l’absence de conviction. Il n’en est évidemment pas question. Toutefois il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique de conviction – dans un langage religieux nous dirions : « Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l’action il s’en remet à Dieu » -, et l’attitude de celui qui agit selon l’éthique de responsabilité qui dit : « Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. » Vous perdrez votre temps à exposer, de la façon la plus persuasive possible, à un syndicaliste convaincu de la vérité de l’éthique de conviction, que son action n’aura d’autre effet que celui d’accroître les chances de la réaction, de retarder l’ascension de sa classe et de l’asservir davantage, il ne vous croira pas. Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes ou encore à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme (car, comme le disait fort justement Fichte, on n’a pas le droit de présupposer la bonté et la perfection de l’homme) et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir. Il dira donc : « Ces conséquences sont imputables à ma propre action. » Le partisan de l’éthique de conviction ne se sentira « responsable » que de la nécessité de veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne s’éteigne pas, par exemple sur la flamme qui anime la protestation contre l’injustice sociale. Ses actes qui ne peuvent et ne doivent avoir qu’une valeur exemplaire mais qui, considérés du point de vue du but éventuel, sont totalement irrationnels, ne peuvent avoir que cette seule fin : ranimer perpétuellement la flamme de sa conviction… Il n’existe aucune éthique au monde qui puisse négliger ceci : pour atteindre des fins « bonnes », nous sommes la plupart du temps obligés de compter avec, d’une part des moyens moralement malhonnêtes ou pour le moins dangereux, et d’autre part la possibilité ou encore l’éventualité de conséquences fâcheuses. Aucune éthique au monde ne peut nous dire non plus à quel moment et dans quelle mesure une fin moralement bonne justifie les moyens et les conséquences moralement dangereuses. » Max WEBER, Le savant et le politique, Plon, 10/18, Paris 1995.
Pour Franz, il y a des actes qu’on ne peut jamais poser, en aucune circonstance, quelles qu’en soient les conséquences. Il articule ainsi « éthique de la conviction » et « éthique de la responsabilité ».En vous aidant du texte de weber, relevez dans le film les scènes et /ou les paroles de Franz qui relèvent de l’éthique de la conviction, celles qui relèvent de l’éthique de la responsabilité et celles qui articulent les deux éthiques.
- Recherchez des exemples dans l’actualité présente de situations qui pourrait s’inspirer de l’analyse de Max Weber sur l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction.
- Au-delà du combat qu’est la guerre, Franz connait un combat interne. Quel ce combat ? Comment se manifeste-t-il ? Quel combat mène –t-il envers les villageois, les soldats, les institutions, avec lesquelles il est en contact, qu’elles soient politiques, religieuses ou militaires ? Ces institutions essaient-elles de comprendre la volonté d’un homme, Franz, de suivre ses convictions personnelles ?
- S’engage pour Franz un combat spirituel long et difficile, qui ressemblerait bien à la Passion. Illustrez-le à travers des scènes et des paroles fortes du film ? Relevez dans le film des signes tangibles de l’évolution de Franz, de cette « figure christique » qu’il représente ?
- La spiritualité reste présente dans « Une Vie Cachée », mais c’est surtout sur la foi. Quelle différence faites-vous entre spiritualité et foi ?entre foi et religion ?
- Qu’apporte la lecture de la Bible à Franz ?
- Considérez-vous ce film comme un sujet fort autour de la désobéissance? Pour quelles raisons ? Jusqu’où peut-on aller dans la désobéissance, au nom de qui ? de quoi ? A exprimer avec des exemples du film et des exemples puisés dans la société actuelle.
- A propos d’ « une vie cachée », on a entendu dire que c’est un hymne au sens moral et au libre-arbitre : Le libre arbitre est une question débattue par les théologiens et les philosophes. Saint Augustin, philosophe et théologien chrétien, a été un des premiers à étudier ce concept de libre arbitre.
En philosophie, le libre arbitre est la capacité d’une personne d’effectuer un choix par elle-même en toute liberté et sans se laisser influencer.
Les actes, les décisions de Franz relèvent- elles vraiment d’un libre arbitre ? Que signifient-elles ? Quelles en sont les portées au niveau politique, au niveau social et au niveau humain ?
Pour Saint Augustin, la volonté libre est un don de Dieu. Pensez- vous qu’il en soit ainsi pour Franz ? Mais n’y – a- t- il pas le silence de Dieu dans le film de Malick ?Qu’en pensez-vous ? Comment le comprenez-vous ?
- Isolé, rejeté, humilié, torturé, Franz s’en remet à Dieu. Il lui parle et il doute face à son silence. Mais Franz ne dévie pas de sa ligne de conduite. Comment l’expliquez-vous ?
- Pour les sociologues, un certain nombre de contraintes vont à l’encontre du libre arbitre. Quelles sont ces contraintes présentées dans le film ? Comment Franz reste-il dans sa ligne de conduite ?
- Notre société actuelle est souvent en contradiction avec la foi chrétienne. Recherchez dans l’actualité présente, au niveau national et/ou international des exemples de contradiction ? Face à vos convictions, vos valeurs, à travers les exemples choisis, quel comportement devons-nous adopter ? Comment se faire entendre face à l’injustice, la violence,… ?
- Raison et foi ? dans « une vie cachée » voyez-vous des divergences entre la raison et la foi, des convergences entre la raison et la foi ? Repérez dans le film des exemples et justifiez.
- Le film se termine par la citation de la romancière George Elliot : « Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu’elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes que personne ne visite plus. » Comment comprenez-vous cette citation à la fin de ce film ?
Philippe Cabrol